
Rapport entre foi et raison : L’impasse du fidéisme
Pour définir le fidéisme, on pourrait dire que c’est l’opposé du rationalisme. C’est le refus de confronter les données de la foi à la raison, comme si la foi ne reposait sur rien de rationnel et n’aurait rien à se faire justifier par la raison. La foi devient simplement une conviction personnelle que j’adopte parce que je veux bien l’adopter. Elle relèverait donc plus d’un volontarisme que d’une réalité à laquelle je devrais me plier. Une personne fidéiste refusera souvent de discuter des raisons pour laquelle elle croit, car elle a volontairement amputée la dimension rationnelle de sa foi. Elle se contentera de vous répondre une petite maxime du genre « Je crois parce que j’y crois », « la foi est une affaire personnelle », « vous n’avez pas vécu ce que j’ai vécu », etc.
Pour donner un exemple d’une vision fidéiste, je vais citer Martin Luther, une figure importante de la réforme protestante : «La raison, c'est la plus grande putain du diable ... qu'on devrait fouler aux pieds et détruire, elle et sa sagesse. Jette-lui de l'ordure au visage pour la rendre laide. Elle est et doit être noyée dans le baptême. Elle mériterait, l'abominable, qu'on la relègue dans le plus dégoûtant lieu de la maison, aux cabinets»*. Je ne veux pas dire par là que tous les chrétiens protestants ont nécessairement une approche fidéiste, mais je crois que cette phrase, malgré son langage vulgaire, représente bien cette position.
Pourquoi le fidéisme est-il aussi une impasse ? Parce que la foi n’a alors aucune base solide pour s’appuyer. La foi est considérée alors comme une affaire d’expérience et de sentiment personnelle. Comme la foi ne s’appuie sur rien de raisonnable, elle a de la difficulté à se communiquer à d’autres personnes et, devant cette absence de raisons, peut ensuite pousser les autres au relativisme ou à l’indifférence religieuse. Pour la personne elle-même, lorsque les bons sentiments ne sont plus ressentis et que les confrontations arrivent (croyez-moi elles arriveront tôt ou tard), on peut alors être tenté de les fuir et de se replier ou même de laisser tomber la révélation du Christ. Ce n’est pas pour rien qu’on peut lire dans la première lettre de Pierre : «Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous».
Selon notre personnalité, certaines personnes sont plus naturellement portées vers l’une ou l’autre des ces impasses. Dans le prochain article, je vais tenter de d’expliquer comment on peut éviter ces deux extrêmes.
* La philosophie du droit de Martin Luther, Tome IV, p. 142
Pour donner un exemple d’une vision fidéiste, je vais citer Martin Luther, une figure importante de la réforme protestante : «La raison, c'est la plus grande putain du diable ... qu'on devrait fouler aux pieds et détruire, elle et sa sagesse. Jette-lui de l'ordure au visage pour la rendre laide. Elle est et doit être noyée dans le baptême. Elle mériterait, l'abominable, qu'on la relègue dans le plus dégoûtant lieu de la maison, aux cabinets»*. Je ne veux pas dire par là que tous les chrétiens protestants ont nécessairement une approche fidéiste, mais je crois que cette phrase, malgré son langage vulgaire, représente bien cette position.
Pourquoi le fidéisme est-il aussi une impasse ? Parce que la foi n’a alors aucune base solide pour s’appuyer. La foi est considérée alors comme une affaire d’expérience et de sentiment personnelle. Comme la foi ne s’appuie sur rien de raisonnable, elle a de la difficulté à se communiquer à d’autres personnes et, devant cette absence de raisons, peut ensuite pousser les autres au relativisme ou à l’indifférence religieuse. Pour la personne elle-même, lorsque les bons sentiments ne sont plus ressentis et que les confrontations arrivent (croyez-moi elles arriveront tôt ou tard), on peut alors être tenté de les fuir et de se replier ou même de laisser tomber la révélation du Christ. Ce n’est pas pour rien qu’on peut lire dans la première lettre de Pierre : «Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous».
Selon notre personnalité, certaines personnes sont plus naturellement portées vers l’une ou l’autre des ces impasses. Dans le prochain article, je vais tenter de d’expliquer comment on peut éviter ces deux extrêmes.
* La philosophie du droit de Martin Luther, Tome IV, p. 142
foiChristbienbaptême
Articles similaires

Les indices pensables: 1- Pourquoi Les indices pensables ?
Cette image est tirée de la bande dessinée Le mystère du soleil froid, Tome 1, page 48 de la série : Les Indices pensables
Les jeunes qui nous entourent sont de...
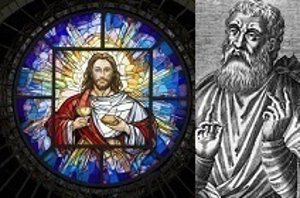
Ils célébraient l’Eucharistie: Justin le martyr
Dans cet article, nous allons poursuivre avec ce qui est probablement la description la plus précise de l’Eucharistie du christianisme primitif. Il s’agit de quelques textes de Justin le martyr,...

Un guide pour approfondir votre vie de foi
Introduction : L'Appel à la Profondeur — Répondre à la Soif de l'ÂmeLe désir d'approfondir sa vie de foi est bien plus qu'une simple curiosité intellectuelle ; il s'agit d'une...

Le Concile Vatican I (1869-1870) : Définition de l'infaillibilité pontificale et réponse au monde moderne
Le Concile Vatican I, tenu de 1869 à 1870, est le vingtième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Pie IX, ce concile est principalement connu pour avoir...
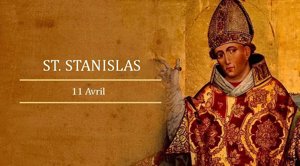
Fête de Saint Stanislas: 11 avril
La fête de Saint Stanislas, célébrée par l'Église Catholique, rend hommage à un évêque et martyr polonais dont la vie et le ministère ont été marqués par un engagement profond...
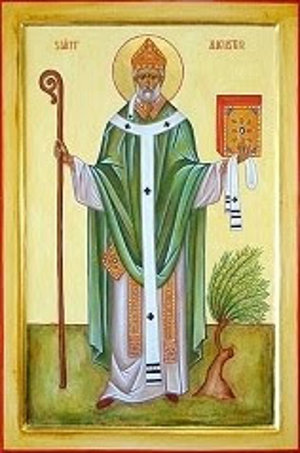
Saint-Augustin et le Canon des Écritures
Il m'est arrivé souvent de pouvoir lire sur des documents chrétiens issus de la Réforme que le concile Catholique de Trente au 16e siècle avait ajouté 7 livres ou parties...

Le Concile de Chalcédoine (451) : La définition de la double nature du Christ
Le Concile de Chalcédoine, tenu en 451, est le quatrième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'empereur romain Marcien et le pape Léon Ier, ce concile avait pour but...

Fête de Saint Thomas: 3 juillet
Le 3 juillet, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Thomas, l'un des douze apôtres de Jésus. Connu souvent comme "Thomas l'incrédule", il est aussi une figure emblématique de la...

Fête de Saint Martin de Tours: 11 novembre
Le 11 novembre, l’Église catholique célèbre la fête de Saint Martin de Tours, un évêque qui a marqué l’histoire de l’Église par sa compassion, sa générosité et sa dévotion à...
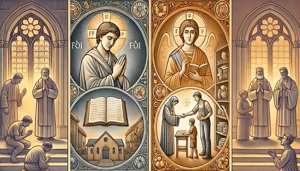
Foi et oeuvres : Une réflexion sur Romains 3
Dans la discussion théologique autour de la justification par la foi, Romains 3, 28 est souvent au centre du débat : « Car nous estimons que l'homme est justifié par...

« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie
Le 1er novembre 1950, en l'année du grand Jubilé, le Pape Pie XII, par la constitution apostolique Munificentissimus Deus, proclamait solennellement le dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie....
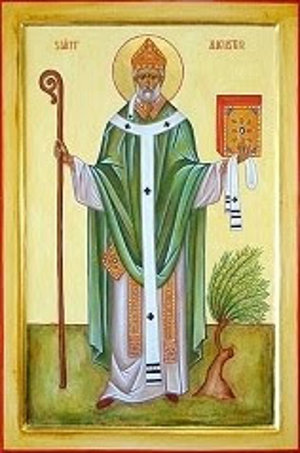
La Foi et les œuvres selon Saint-Augustin
LA FOI SANS LES ŒUVRES NE SUFFIT PAS POUR ÊTRE SAUVÉ.
Arrivons donc à cette erreur que doivent rejeter toutes les âmes chrétiennes, si elles ne veulent perdre, la félicité éternelle...

Fête de Saint Cyrille de Jérusalem: 18 mars
Le 18 mars, l'Église catholique célèbre Saint Cyrille de Jérusalem, un évêque et docteur de l'Église du IVe siècle, reconnu pour son enseignement profond et ses écrits catéchétiques. Né aux...

Le Concile de Trente (1545-1563) : La réponse catholique à la Réforme protestante
Le Concile de Trente, tenu de 1545 à 1563, est le dix-neuvième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Paul III, ce concile est considéré comme l'un des...

Fête de Saint Damase 1er: 11 décembre
La fête de Saint Damase Ier, célébrée le 11 décembre, offre une occasion remarquable de plonger dans l'histoire de l'Église catholique et de reconnaître les contributions significatives de ce pape...
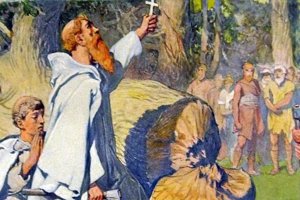
Fête de Saint Boniface: 5 juin
Le 5 juin, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Boniface, un évêque et martyr connu comme l'apôtre de l'Allemagne. Né en Angleterre vers 675 sous le nom de Wynfrid,...
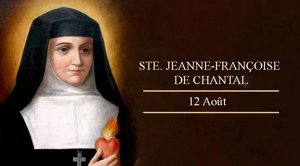
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal: 12 aout
Le 12 août, l'Église catholique célèbre la mémoire de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, une femme remarquable qui a dédié sa vie à la charité, à la prière et à la...

Preuve par témoignage
« Je n’ai pas la foi puisque je suis rationnel ; j’exige des preuves pour croire. Ce que je crois est fondé sur des preuves, pas sur des émotions ou...

Fête de Saint Fidèle de Sigmaringen: 24 avril
Saint Fidèle de Sigmaringen, né sous le nom de Mark Roy, est une figure emblématique de la foi catholique, célébré le 24 avril chaque année. Sa vie dédiée à la...

La fête de Saints Corneille et Cyprien : 16 septembre
Le 16 septembre, l'Église catholique célèbre avec ferveur la fête de deux saints emblématiques de l'Église primitive : Saint Corneille et Saint Cyprien. Ces deux figures majeures du christianisme des...