
Dignitatis Humanae : vue sous une herméneutique de la continuité (1/2)

Poser la bonne question
Pour bien interpréter Dignitatis Humanae, il est primordial de bien cerner la question que veut développer le document. Pour ce faire, nous allons examiner un extrait de son introduction :
Tous les hommes, d’autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et, quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles.
De même encore, le saint Concile déclare que ces devoirs concernent la conscience de l’homme et l’obligent, et que la vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l’esprit avec autant de douceur que de puissance. Or, puisque la liberté religieuse, que revendique l’homme dans l’accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu, concerne l’exemption de contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ. En outre, en traitant de cette liberté religieuse, le saint Concile entend développer la doctrine des Souverains Pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l’ordre juridique de la société (DH 1).Après avoir fait la lecture de cet extrait, nous devons comprendre une chose fondamentale : il n'est pas question, dans ce document, de répondre à la question à savoir si tous les hommes sont tenus de chercher la vérité et de lui être fidèle. À cette question, le document répond lui-même qu'il « ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ ». La question précise auquel veut répondre ce document « concerne l’exemption de contrainte dans la société civile ». Autrement dit, Dignitatis Humanae ne veut pas développer la question à savoir si tous les hommes doivent professer la foi catholique et appartenir à l'Église catholique. La réponse est déjà donnée par l'affirmative dans son introduction. La question qui sert de fondation au document est :comment doit-on traiter les personnes qui ne professent pas la foi catholique et qui n'appartiennent pas à l'Église catholique. Cette distinction est tout à fait fondamentale pour pouvoir comprendre Dignitatis Humanae dans une herméneutique de continuité.
Droit et libre arbitre
Dignitatis Humanae va explorer un peu le mystère du libre arbitre de l'homme, c'est à dire de cette liberté qu'a l'homme à pouvoir choisir ses actions et ses pensées, en relation avec la souveraineté de Dieu. Dieu exige que tout homme l'adore et le serve, mais Dieu nous a aussi laissés libres de lui désobéir. Comme les droits absolus de l'homme proviennent de ce que Dieu lui permet, l'homme est libre de désobéir à Dieu, mais il n'a pas le droit de lui désobéir.
À ce point on voit un peu mieux la différence entre ce que l'homme est libre de faire et ce que l'homme a le droit de faire. Utilisons un exemple concret pour illustrer cela : un homme s'introduit dans un magasin d'informatique pour y voler un ordinateur. Bien entendu, cet homme est libre de commettre cet acte en exerçant par là son libre arbitre. Cependant, il n'a pas le droit de voler un ordinateur et cela sera très clair lorsqu'il se fera arrêter par la police pour cet acte.
La source de la confusion
La cause de beaucoup de confusion au sujet de Dignitatis Humanae est qu'on a souvent tendance à ignorer les définitions et les explications données par le document lui-même et qu'on a aussi tendance à importer les concepts qui proviennent de nos sociétés ou de nos cultures dans le texte. Par exemple, lorsque Dignitatis Humanae parle de « liberté religieuse », certains vont remplacer cela par « séparation de l'Église et de l'État » en interprétant le texte, parce que c'est ce que cela en est venu à signifier pour une bonne partie de l'occident. La « liberté religieuse » dont il est question dans le document est l'immunité contre la contrainte de la société civile afin que l'homme puisse rendre le culte dû à Dieu. Ce droit à la liberté religieuse est fondé sur la dignité humaine, qui a sa source en Dieu qui a créé l'homme libre.
La réponse de Dignitatis Humanae
Une fois ces distinctions faites et lorsqu'on a bien identifié la question du document, nous pouvons alors examiner comment Dignitatis Humanae répond à la question: comment doit-on traiter les personnes qui ne professent pas la foi catholique et qui n'appartiennent pas à l'Église catholique? La réponse en bref est : cet homme doit demeurer libre de toute contrainte et il ne doit pas être forcé à agir contrairement à ses croyances. Pour allez plus loin, il nous faut alors faire une distinction entre ce qui est passif et ce qui est actif. L'aspect passif comprend les choses que nous ne faisons pas à cause de nos croyances et l'aspect actif comprend ce que nous faisons à cause de nos croyances.
Prenons par exemple Omar, un musulman qui vient tout juste d’immigrer au Québec. Bien entendu, comme Omar est musulman et qu'il ne croit pas au mystère de l'Eucharistie, Omar ne va pas à la Messe le dimanche matin. S’il y avait au Québec une loi qui obligerait tous les citoyens à aller à la Messe le dimanche et qu'on arrêtait Omar parce qu'il est demeuré à la maison, alors cela serait une violation de la liberté religieuse d'Omar où il aurait été contraint d'agir contrairement à ses croyances.
Qu'arrive-t-il si on regarde du côté de l'aspect actif? Par exemple, prenons comme exemple Anton qui est un sataniste. Pour être fidèle à ses croyances, Anton doit rendre un culte à Satan jeudi soir prochain avec des amis. Nous avons donc ici affaire à l'aspect actif, c'est-à-dire à quelque chose qu'Anton doit faire pour agir selon ses croyances. Bien entendu, selon le principe de liberté religieuse, Anton demeure toujours libre de participer à ce culte satanique. Cependant, si ce culte nécessitait qu'on y sacrifie un enfant, la réalité serait tout autre. On se rend alors compte que l'aspect actif de la liberté religieuse devient de moins en moins absolu et que le problème devient plus un problème de prohibition que de contrainte, puisqu'on ne peut pas laisser Anton et ses amis tuer un enfant pour rendre son culte. Cette limite se retrouve bien exprimée dans Dignitatis Humanae :
C’est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste (DH 2).Nous voyons donc que Dignitatis Humanae essaie de maintenir un certain équilibre, puisque l'immunité de contrainte entraîne aussi en partie aussi l'immunité de prohibition. Cependant, l'immunité de prohibition est davantage contingente puisqu'elle peut être limitée afin de conserver l'ordre public. Cependant, il ne faut jamais confondre ce droit à ne pas subir la contrainte avec le droit à propager l'erreur. L'erreur n'a pas de droit, elle peut seulement être tolérée pour conserver l'ordre public dans certaines circonstances.
Et où la continuité dans tout ça? C'est ce que nous verrons bientôt dans la deuxième partie de l'article.
églisedieucatholiquebien
Articles similaires
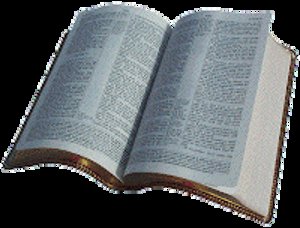
Comment interpréter la Bible – Partie 3
Nous voilà donc rendu à la partie finale qui demande encore un peu de recherche. En tant que Catholique, nous avons la chance de pouvoir vérifier nos interprétations avec celles...

Le protestantisme (1/4) : Qui sont les Protestants?
Le terme Protestant ne fait pas unanimité à l'intérieur du protestantisme. Ce sont surtout les groupes protestants historiques, ceux qui s'identifient au mouvement théologique initié par Martin Luther au 16e...
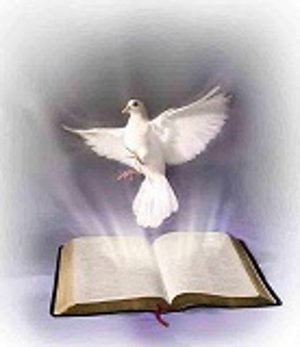
Catholique et protestant : Discussion sur l’inspiration et le canon
Dans les discussions entre catholiques et protestants, un des sujets le plus importants est probablement la question de la Bible. Comme vous le savez, la Bible catholique (73 livres) contient...
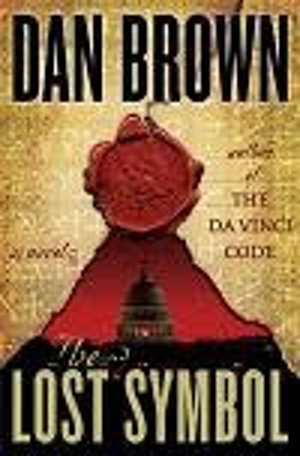
Le chat de Dan Brown est enfin sorti du sac !
Je dois d’abord avouer que j’aime bien lire les romans de Dan Brown. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est l’auteur du « Da Vinci code », «...

Les 4 caractéristiques de la Véritable Église : L’Église est Une
Premièrement, l’Église est unique de par sa source qui est un Dieu unique dans les 3 personnes de la Trinité. L’Église est unique par son fondateur Jésus-Christ qui a réconcilié...

Saint Étienne de Hongrie: 16 aout
Le 16 août, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Étienne de Hongrie, un souverain exceptionnel dont le règne a marqué l'histoire de la Hongrie et de l'Église. Né vers...

Jésus n’est pas venu sur Terre pour fonder une religion!
« Jésus n’est pas venu sur Terre pour fonder une religion! » On entend souvent cette phrase. Elle fait parti des phrases programmés dans nos têtes que tout le monde...

Réflexions bibliques du 9 novembre 2014: Bâtissons le Corps
Lectures de la liturgie
Bâtissons le Corps
Pourquoi commémorer la dédicace d’une l'église de Rome du quatrième siècle ? D'abord, parce que Saint-Jean-de-Latran n’est pas une église ordinaire, c’est la cathédrale du...

Le Concile Vatican I (1869-1870) : Définition de l'infaillibilité pontificale et réponse au monde moderne
Le Concile Vatican I, tenu de 1869 à 1870, est le vingtième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Pie IX, ce concile est principalement connu pour avoir...

La morale chrétienne : les bases
Conversion, sanctification, suite du christ, doctrine sociale, la grâce et le péché : la morale chrétienne peut paraît compliqué. La morale chrétienne n’est pas une liste d’interdits ou d’impératifs catégoriques...

Saint Grégoire le Grand: 3 septembre
Le 3 septembre, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint Grégoire le Grand, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Sa vie et son œuvre demeurent une source...
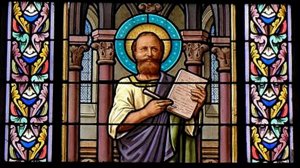
Saint Pontien et Saint Hippolyte: 13 aout
Le 13 août, l'Église catholique célèbre la mémoire de deux grands martyrs du IIIe siècle, le pape Pontien et le prêtre Hippolyte. Leur histoire est une illustration éloquente de la...

Fête de Saint Thomas: 3 juillet
Le 3 juillet, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Thomas, l'un des douze apôtres de Jésus. Connu souvent comme "Thomas l'incrédule", il est aussi une figure emblématique de la...
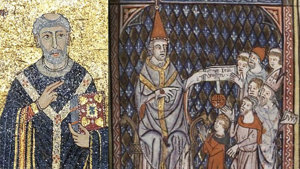
Fête du pape saint Callixte 1er : 14 octobre
Le 14 octobre, l’Église catholique célèbre la mémoire de saint Callixte Ier, le pape qui a fait preuve d’une grande miséricorde envers les pécheurs et les pauvres. Qui était ce...
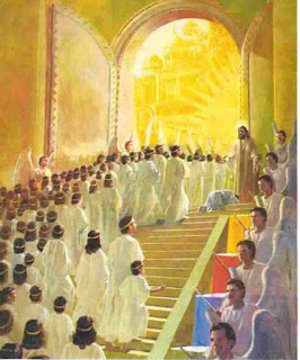
Le vaste malentendu et le vrai désaccord
Si quelqu'un souhaite revisiter toute la chronologie de l'échange, je précise que le présent article est une réponse à cet article de Pascal, qui est une réponse à cet article...
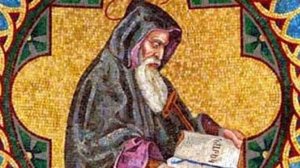
Fête de Saint Grégoire de Narek: 27 février
Le 27 février, l'Église catholique commémore un saint d'une profondeur spirituelle exceptionnelle, Saint Grégoire de Narek. Moine, théologien, et poète arménien du Xe siècle, Grégoire de Narek est un trésor...

« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie
Le 1er novembre 1950, en l'année du grand Jubilé, le Pape Pie XII, par la constitution apostolique Munificentissimus Deus, proclamait solennellement le dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie....

Fête de Saint Pierre Damien: 21 février
Le 21 février, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint Pierre Damien, un érudit, réformateur, et un saint dont la vie et l'œuvre continuent d'inspirer les fidèles à travers les...
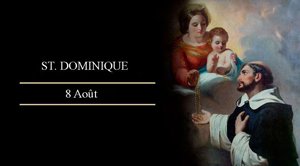
Saint Dominique: 8 aout
Le 8 août, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Dominique, fondateur de l'Ordre des Prêcheurs, plus connu sous le nom de Dominicains. Saint Dominique de Guzmán, né en 1170...

Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence (1431-1449) : Tentative de réunification avec l'Église orthodoxe et affirmation de l'autorité papale
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence, tenu de 1431 à 1449, est le dix-septième concile œcuménique de l'Église catholique. Ce concile fut initialement convoqué pour poursuivre la réforme de l'Église et tenter...