
Le latin: la langue de l'Église (2/5)
 |
| Le concile Vatican II n'a pas aboli le latin |
Le bienheureux pape Jean XXIII, celui même qui a convoqué le concile Vatican II, nous a laissé pour monument à sa mémoire sa constitution apostolique Veterum Sapientia (la Sagesse des Anciens). Une « constitution apostolique » est le niveau de document le plus élevé qui puisse être émis par un pape concernant la foi, les mœurs et l'administration de l'Église. Dans ce document, le pape encourage, demande et ordonne, en des termes très percutants, non seulement que l'on préserve l'usage du latin, mais que l'on prenne des mesures pour restaurer sa place dans l'Église.
Ce n'est pas une coïncidence que Veterum Sapientia ait été émis quelques mois avant le début du concile Vatican II, puisqu'au début des années 1960, le latin était déjà en état de siège dans la société et au sein même de l'Église. On peut supposer que le pape, en écrivant ce document, avait voulu mettre la table en affirmant clairement les liens entre la langue latine et l'identité de l'Église, de sorte que le concile lui reconnaisse sa juste valeur.
Au concile Vatican II, divers courants progressistes et conservateurs se sont affrontés sur la question du latin. Contrairement à l'opinion reçue, le latin n'a pas été « aboli » par le concile Vatican II. Au contraire, le concile a fait ce que le pape Jean XXIII avait souhaité. Dans le document conciliaire Sacrosanctum Concilium, on lit clairement : « L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins » (SC 36). Ceux qui font dire au concile qu'il a abandonné le latin ont non seulement oublié de lire les documents du concile, mais laissent entendre que le concile est allé à l'encontre de toute la tradition l'Église, y compris l'enseignement du pape même qui a convoqué ce concile. Une telle affirmation, que le pape émérite Benoît XVI appelle « l'herméneutique de la rupture », n'est tout simplement pas catholique.
Donc, il est parfaitement faux d'affirmer que le concile a aboli le latin. Aussi, il est inexact d'affirmer que le concile a autorisé la messe en langue vernaculaire, alors que les documents du concile parlent simplement de la possibilité d'accorder à la langue vernaculaire « une plus large place » (SC 37 et 63), comme dérogation à la norme qui demeure le latin. Les pères du concile n'ont jamais envisagé que la messe soit dite entièrement en français et encore moins que la plupart des catholiques du 21e siècle n'aient jamais entendu un mot de latin à la messe. Au contraire, le concile écrit : « On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent » (SC 54).
Alors nous le voyons, le latin n'a pas cessé d'être la langue de l'Église depuis Vatican II. Le concile n'a pas aboli le latin et il n'a pas mandaté que la messe soit dite entièrement en français. Il est vrai qu'une présence accrue des langues vernaculaires a été envisagée par le concile, sans pourtant qu'elles éclipsent le latin. On peut émettre toutes sortes d'hypothèses pour expliquer pourquoi on n'entend plus un mot de latin aujourd'hui à la messe. Certains invoqueront « l'esprit » de Vatican II pour justifier cette rupture de la tradition millénaire de l'Église, mais il est difficile de comprendre comment « l'esprit » du concile peut contredire les documents de ce même concile. En fait, cet « esprit » est nul autre que l'hérésie moderniste qui voit dans le latin un symbole très fort de la tradition et de l'orthodoxie.
Dans le prochain billet, nous verrons plus en détail le rôle du latin tel qu'envisagé dans Veterum Sapientia et ce que nous pouvons faire pour mettre à profit ce trésor de l'Église.
concileégliseVaticanpape
Articles similaires

Le Concile de Constantinople III (680-681) : La condamnation du monothélisme et l'affirmation des deux volontés du Christ
Le Concile de Constantinople III, tenu de 680 à 681, est le sixième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'empereur Constantin IV et présidé par le patriarche de Constantinople,...

Nouvel outil pour découvrir les conciles œcuméniques
Ces derniers temps, j'ai travaillé à la construction d'un nouvel outil pour vous aider à mieux découvrir les conciles œcuméniques. Je trouve qu'étudier l'histoire des grands conciles est une excellente...

Le Concile de Constance (1414-1418) : Fin du Grand Schisme d'Occident et réformes ecclésiastiques
Le Concile de Constance, tenu de 1414 à 1418, est le seizième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'empereur Sigismond et le pape Jean XXIII (un des trois papes...

Suffisance des Saintes Écritures… et Lego
Une histoire de lego
L’an passé je passais devant une « vente de garage » avec mon fils, lorsque je vis une bonne aubaine. Un château en lego d’une valeur de...

Le Concile de Latran IV (1215) : Le grand concile de la réforme et de la définition dogmatique
Le Concile de Latran IV, tenu en 1215 sous le pape Innocent III, est le douzième concile œcuménique de l'Église catholique et l'un des plus importants de l'histoire de l'Église...

Le Concile de Chalcédoine (451) : La définition de la double nature du Christ
Le Concile de Chalcédoine, tenu en 451, est le quatrième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'empereur romain Marcien et le pape Léon Ier, ce concile avait pour but...

Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence (1431-1449) : Tentative de réunification avec l'Église orthodoxe et affirmation de l'autorité papale
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence, tenu de 1431 à 1449, est le dix-septième concile œcuménique de l'Église catholique. Ce concile fut initialement convoqué pour poursuivre la réforme de l'Église et tenter...

Le Concile de Nicée II (787) : La défense des saintes images et la fin de l'iconoclasme
Le Concile de Nicée II, qui s'est tenu en 787, est le septième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'impératrice Irène et son fils Constantin VI, ce concile visait...

Le Concile de Lyon II (1274) : Tentative de réunification avec les Églises orientales et réforme ecclésiastique
Le Concile de Lyon II, tenu en 1274, est le quatorzième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Grégoire X, ce concile visait principalement à restaurer l'unité entre...

Rapport entre foi et raison : La foi transrationnelle
Après avoir examiné les deux impasses du rationalisme et du fidéisme, on peut aussi remarquer qu’autant historiquement que personnellement, on peut passer facilement d’un extrême à l’autre. Par exemple, je...

Le Concile de Latran II (1139) : Réaffirmation de la discipline ecclésiastique et résolution du schisme papal
Le Concile de Latran II, qui s'est tenu en 1139, est le dixième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Innocent II, ce concile avait pour objectif principal...

Le Concile d'Éphèse (431) : Marie, Mère de Dieu et l’unité de la personne du Christ
Le Concile d'Éphèse, qui s'est tenu en 431, est le troisième concile œcuménique de l'Église catholique. Ce concile, convoqué par l'empereur Théodose II et le pape Célestin Ier, avait pour...

Le Concile de Constantinople II (553) : La confirmation des décisions précédentes et la condamnation des « Trois Chapitres »
Le Concile de Constantinople II, qui s'est tenu en 553, est le cinquième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par l'empereur Justinien Ier et présidé par le patriarche de Constantinople,...
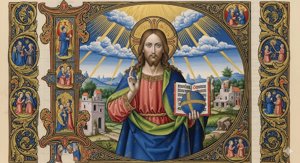
Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ
Introduction : Le paradoxe divin au centre de notre foiAu cœur de la foi catholique, et plus largement de tout le christianisme, se trouve une affirmation qui défie la simple...
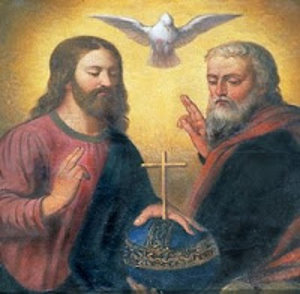
12 choses à savoir et partager à propos de la Sainte Trinité
L'Église enseigne que la Sainte Trinité est le mystère central de la foi chrétienne.
Mais que savez-vous au sujet de ce mystère?
Quelle est son histoire?
Qu'est-ce qu’elle signifie?
Et comment peut-elle être prouvé?
Voici...

Le Concile de Latran III (1179) : Réforme de l'élection papale et lutte contre les hérésies
Le Concile de Latran III, tenu en 1179, est le onzième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Alexandre III, ce concile visait principalement à réformer l'élection papale...

Introduction aux grands conciles de l'Église : pourquoi sont-ils essentiels pour comprendre la foi catholique aujourd'hui ?
L'Église catholique, au cours de ses deux millénaires d'histoire, a traversé de nombreux défis et a dû répondre à des questions fondamentales concernant la foi, la morale et la doctrine....

Le Concile de Vienne (1311-1312) : Suppression des Templiers et réforme de l'Église
Le Concile de Vienne, tenu de 1311 à 1312, est le quinzième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Clément V, ce concile fut principalement marqué par la...

Le Concile de Constantinople I (381) : La confirmation de la doctrine de la Trinité
Le premier Concile de Constantinople, qui s'est tenu en 381, est le deuxième concile œcuménique de l'Église catholique et orthodoxe. Convoqué par l'empereur Théodose Ier, ce concile a été principalement...
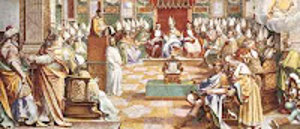
L'empereur Constantin, Nicée et la Trinité
Certains groupes affirment que l'Église et les enseignements des Apôtres ont été corrompus dès le premier concile œcuménique de Nicée en 325. Cette doctrine porte généralement le nom de «...