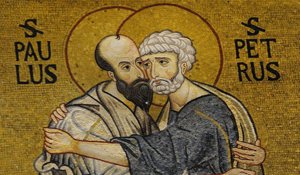La primauté de Pierre : fondement de l'unité voulue par le Christ

Introduction : La question de la primauté au cœur de l'ecclésiologie et de l'unité
La doctrine de la primauté de l'Évêque de Rome, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, constitue l'un des piliers de l'ecclésiologie catholique. Elle est comprise comme l'institution divine par laquelle l'Église du Christ conserve son unité de foi et de communion à travers le temps. Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, affirme que le Pontife romain est « le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles ».
Cette primauté, voulue par le Christ lui-même, n'est pas un pouvoir de domination ou un honneur temporel. Elle est un ministère (un service) ordonné à la sauvegarde du « dépôt de la foi » et à la mission confiée à Pierre par le Christ : « confirmer ses frères ». Elle est au service de la communion.
Il est essentiel de définir d'emblée la nature de cette primauté, car c'est là que réside le cœur des débats théologiques et œcuméniques. La doctrine catholique ne se contente pas d'une "primauté d'honneur" – être le premier parmi ses pairs (primus inter pares), comme le conçoit par exemple l'Église orthodoxe. Elle affirme une "primauté de juridiction".
Cela signifie que le Pape, en tant que successeur de Pierre, détient une autorité réelle, un « pouvoir suprême » de gouvernement spirituel. Cette autorité exige « la soumission proprement dite, l'obéissance extérieure et intérieure » de la part de tous les membres de l'Église. Le Concile Vatican I, dans la constitution Pastor Aeternus, a défini ce pouvoir comme étant « plénier et souverain », « ordinaire » (c'est-à-dire inhérent à sa charge et non délégué par d'autres) et « immédiat » (s'exerçant directement sur tous les pasteurs et tous les fidèles, sans intermédiaire).
La nature juridictionnelle de cette primauté découle logiquement de sa finalité. Si le Christ a institué une Église une (comme il le prie dans Jn 17) et indéfectible, promise à ce que « la puissance de la Mort » n'ait pas de force contre elle , il était nécessaire d'instituer un moyen visible et efficace pour garantir cette unité de foi et de gouvernement à travers l'histoire. Une simple "primauté d'honneur" serait un titre sans autorité, incapable de trancher les controverses doctrinales ou de résoudre les schismes. La fonction de "fondement visible" confiée à Pierre exige la nature d'une autorité suprême et juridictionnelle.
Cet article explorera les fondements de cette doctrine, enracinée dans l'Écriture sainte, attestée par la Tradition de l'Église primitive, et définie infailliblement par le Magistère, tout en offrant des réponses apologétiques aux objections les plus courantes.
Partie 1 : Les fondements scripturaires de l'institution pétrinienne
L'Église catholique n'appuie pas la doctrine de la primauté sur un verset isolé, mais sur une convergence de paroles et d'actes de Jésus-Christ, transmis par les Évangiles. Ces "lieux pétriniens" majeurs montrent le Christ conférant à Simon, et à lui seul, une charge unique au sein du collège des Douze.
1.1. La promesse à Césarée de Philippe (Mt 16, 13-19)
Le passage le plus explicite est sans doute la grande confession de Césarée de Philippe. Après que Simon a confessé la divinité de Jésus (« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »), Jésus lui répond par une triple investiture.
Le texte, tel qu'utilisé dans la liturgie du 29 juin pour la fête de Saint Pierre et Saint Paul, est le suivant :
« Jésus reprit la parole et lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » ».
Trois éléments de ce texte fondent la primauté :
"Tu es Pierre, et sur cette pierre"
Le premier acte de Jésus est de donner un nouveau nom, qui signifie sa nouvelle fonction. L'objection protestante classique, basée sur la langue grecque, tente d'opposer Petros (nom masculin, "Pierre" ou "caillou") à petra (nom féminin, "Roc" ou "massif rocheux"). Selon cette vue, Jésus distinguerait la petite "pierre" (Pierre) du "roc" (soit le Christ lui-même , soit la foi de Pierre ).
Cette objection s'effondre lorsqu'on la confronte à la langue que parlait Jésus : l'araméen. En araméen, il n'y a pas de distinction grammaticale. Jésus aurait dit : « Tu es Kèphas, et sur ce Kèphas je bâtirai mon Église ». Kèphas (transcrit en grec, et utilisé par saint Paul) signifie "Roc". L'évangéliste Matthieu, écrivant en grec, a dû masculiniser le nom du fondement (petra) en Petros pour l'attribuer à un homme, mais le jeu de mots en araméen ne laisse aucun doute : la personne de Pierre est le roc sur lequel l'Église est bâtie.
De même, l'idée que la "pierre" est la foi de Pierre est une fausse dichotomie. Jésus ne dit pas : « Ta foi est la pierre », mais « Tu es Pierre ». L'Église est bâtie sur la personne de Simon, en raison de cette foi que le Père lui a révélée. Le charisme est donné à l'homme et à l'office qu'il inaugure. C'est précisément parce que Pierre est un homme faible que son choix comme Roc démontre que la solidité de l'Église "n'est pas la conséquence des forces humaines", mais qu'elle appartient au Christ.
"Je te donnerai les clés du royaume"
Le deuxième acte est la remise des clés. Ce pouvoir est donné à Pierre seul. Il ne s'agit pas d'une simple image ; c'est une référence directe et délibérée à une institution de l'Ancien Testament : la fonction d'intendant, ou "Maître du Palais", dans la monarchie davidique, décrite dans Isaïe 22, 20-22.
Dans ce passage, Dieu annonce qu'il va destituer l'intendant infidèle Shebna et installer Éliakim à sa place :
« Je le couvrirai de ta tunique... je lui remettrai ton pouvoir... Je lui remettrai la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. ».
L'intendant porteur de la "clé de la maison de David" n'est pas le roi. Il est le vicaire du roi, celui qui gouverne la maison (le royaume) avec l'autorité du roi, en son absence. L'objection selon laquelle Éliakim est un type du Christ est juste, mais incomplète. Le Christ, en tant que véritable Roi Davidique, possède la clé (voir Ap 3, 7). Mais dans Mt 16, Il fait ce qu'un roi fait : il nomme son intendant, son vicaire, Pierre. En lui remettant les "clés" (au pluriel, signifiant une autorité complète ), Jésus confère à Pierre l'autorité suprême pour gouverner "l'Église" (la "maison de Dieu" du Nouveau Testament) en son nom.
"Tout ce que tu auras lié..."
Le troisième acte est le pouvoir de "lier et délier". Si ce pouvoir est donné plus tard à l'ensemble du collège apostolique (Mt 18, 18), il est donné ici à Pierre personnellement et en premier, conjointement avec les clés qui, elles, ne sont jamais données aux autres. L'autorité de Pierre est donc unique.
1.2. La mission de confirmation (Lc 22, 31-32)
Lors de la Cène, juste avant sa Passion, Jésus s'adresse à nouveau à Simon de manière singulière. Le texte est :
« Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. ».
L'analyse de ce passage est cruciale.
- Jésus utilise d'abord un pluriel : Satan réclame de cribler "vous" (hymas), c'est-à-dire tous les apôtres. L'attaque vise tout le collège.
- Jésus utilise ensuite un singulier : « Mais j’ai prié pour toi (sou) ». Face à une attaque collective, Jésus répond par une protection individuelle et spécifique ciblant Simon.
- La prière du Christ n'est pas un simple souhait, elle est divinement efficace. Elle confère à Pierre un charisme spécial : sa foi (la foi attachée à son office) ne "défaillira pas".
- La finalité de ce don personnel est ecclésiale : « affermis tes frères ». Pierre, une fois "revenu" de son reniement, est chargé de devenir le point de solidité pour l'ensemble du collège apostolique.
Ce passage est le fondement scripturaire du magistère pétrinien et de la doctrine de l'infaillibilité. L'assistance promise par le Christ à Pierre pour "garder le dépôt de la foi" est la garantie que l'Église restera fondée sur la vérité.
1.3. La charge pastorale universelle (Jn 21, 15-17)
Après la Résurrection, sur les bords du lac de Tibériade, Jésus investit solennellement Pierre de sa charge. Le texte rapporte le triple dialogue :
« Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci? » Il lui répond : « Oui, Seigneur! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu? » Pierre fut peiné... Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » ».
Cette triple question répare le triple reniement de Pierre. Mais c'est bien plus qu'une réhabilitation personnelle ; c'est une investiture publique.
Le point théologique central est la nature du troupeau confié. Jésus, le seul Bon Pasteur, confie l'intégralité de son troupeau à Pierre. L'exégèse patristique et magistérielle a souvent vu dans la distinction entre les "agneaux" (arnia) et les "brebis" (probata) la totalité de l'Église : les "agneaux" représentent les fidèles (le laïcat), et les "brebis" (qui sont aussi mères des agneaux) représentent les pasteurs, c'est-à-dire les autres apôtres et leurs successeurs.
En faisant de Pierre le pasteur des "agneaux" et des "brebis", le Christ lui confère une juridiction universelle, le chargeant d'être le pasteur suprême de l'Église entière, incluant les pasteurs et les fidèles. C'est ce que le Concile Vatican I a défini comme la juridiction sur "tous et chacun des pasteurs et des fidèles".
Tableau récapitulatif : Les trois piliers de la primauté pétrinienne
Ces trois passages convergent pour brosser un portrait cohérent de l'office pétrinien, tel que voulu par le Christ.
| Passage Biblique | L'Acte du Christ | La Charge confiée à Pierre | Nature de la Primauté |
| Mt 16, 18-19 | Promesse (Fondation) | Le Fondement ("sur cette pierre") et l'Autorité ("les clés"). | Juridictionnelle et Doctrinale (pouvoir de lier/délier). |
| Lc 22, 31-32 | Prière (Charisme) | La Confirmation ("affermis tes frères"). | Magistérielle (garant de la foi indéfectible). |
| Jn 21, 15-17 | Investiture (Mission) | Le Pastorat Universel ("Sois le berger de mes brebis"). | Gouvernementale (pasteur des fidèles et des pasteurs). |
Partie 2 : Le témoignage de la tradition : la primauté dans l'église primitive
L'autorité unique conférée à Pierre ne s'est pas éteinte avec sa mort. L'office pétrinien, étant le fondement de l'Église qui doit durer jusqu'à la fin des temps, est nécessairement transmissible. La Tradition de l'Église primitive atteste que, très tôt, l'Évêque de Rome – successeur de Pierre sur le siège où l'Apôtre a subi le martyre – a exercé cette primauté.
2.1. L'intervention de Clément de Rome (vers 96 ap. J.-C.)
L'un des témoignages les plus précoces et les plus frappants est la Première épître de Clément, évêque de Rome, à l'Église de Corinthe. Vers l'an 96, un grave conflit éclate à Corinthe : de jeunes membres de la communauté ont fomenté une sédition et ont réussi à déposer les presbytres (prêtres) légitimement installés.
C'est alors que l'Église de Rome, par la plume de son évêque Clément, intervient. La lettre, rédigée avec une autorité pastorale évidente, exhorte les Corinthiens à la paix, leur rappelle la structure hiérarchique voulue par Dieu et les somme de restaurer les presbytres dans leurs fonctions.
La signification de cet acte est immense. À l'époque de la rédaction (vers 96), l'apôtre Jean est très probablement encore en vie et se trouve à Éphèse, géographiquement beaucoup plus proche de Corinthe. Pourtant, ni Jean ni une autre Église d'Asie Mineure n'interviennent. C'est l'Église de Rome, située à l'autre bout de la Méditerranée, qui prend l'initiative de régler un conflit interne à une autre Église.
Comme l'a souligné le Pape Benoît XVI lors d'une audience, cette intervention ne peut se comprendre que comme un « premier exercice du Primat romain » après le martyre de Pierre. L'Église de Rome, décrite peu après par saint Ignace d'Antioche comme celle "qui préside à la charité" , manifeste dès la fin du Ier siècle sa "sollicitude" spéciale pour l'unité et l'ordre de l'Église universelle.
2.2. Saint Irénée de Lyon et la "principauté plus excellente" (vers 189 ap. J.-C.)
Environ un siècle plus tard, saint Irénée, évêque de Lyon mais originaire d'Orient (disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Jean), fournit un témoignage capital. Dans son grand traité Contre les hérésies (Adversus Haereses), Irénée cherche à réfuter les gnostiques qui prétendent détenir une tradition secrète.
Pour Irénée, le critère de la vérité est la "succession apostolique" : la foi prêchée publiquement par les Apôtres et transmise fidèlement par la succession ininterrompue des évêques. Conscient qu'il serait "très long... d'énumérer les successeurs de toutes les églises", Irénée prend un exemple paradigmatique :
«...nous parlerons de l'église très grande, très connue et très antique parmi toutes, fondée et constituée par les deux apôtres Pierre et Paul à Rome... C'est avec cette église, à cause de sa principauté plus forte [ou 'origine supérieure', potentior principalitas] qu'il est nécessaire que s'accorde [convenire] toute église, c'est-à-dire ceux qui sont des fidèles de partout, elle en qui toujours... a été conservée cette tradition venue des apôtres. » (Adversus Haereses, III, 3, 2).
Certains critiques ont tenté de vider ce texte de son sens ecclésiologique, en prétendant que la potentior principalitas faisait référence à l'importance politique de Rome, capitale de l'Empire, et que convenire signifiait simplement "s'y rendre" (voyager).
Cette interprétation ne résiste pas au contexte. Irénée écrit un traité de théologie pour réfuter des hérésies. L'importance de Rome pour lui n'est pas civile, mais spirituelle : c'est le lieu où la tradition apostolique de Pierre et Paul est conservée de la manière la plus pure. Par conséquent, le convenire (s'accorder) est nécessairement doctrinal. Pour Irénée de Lyon, au IIe siècle, l'Église de Rome est l'étalon de l'orthodoxie, le point de référence avec lequel toute l'Église doit être en communion de foi.
2.3. Saint Cyprien de Carthage et la "Chaire de Pierre" (vers 251 ap. J.-C.)
Au IIIe siècle, en Afrique du Nord, saint Cyprien de Carthage développe une théologie profonde de l'unité de l'Église, en réponse au schisme de l'antipape Novatien. Dans son traité De l'unité de l'Église (De unitate Ecclesiae), il articule l'idée que si l'épiscopat est un et indivis, cet épiscopat a une source, une origine, pour manifester son unité : la "Chaire de Pierre" (Cathedra Petri).
Cyprien écrit :
« Sur lui [Pierre] il bâtit son Église... pour maintenir l'unité, il a par Sa propre autorité placé une source unique de l'unité, venant d'un seul. ».
Il pose ensuite la question rhétorique : « Quiconque déserte la chaire de Pierre, sur lequel est fondée l'Église, se flatte-t-il d'être dans l'Église? ».
Les critiques (orthodoxes et protestants) soulèvent deux objections majeures : premièrement, il existerait deux versions de ce texte, et les passages les plus "romains" (le "Texte de la Primauté") seraient des interpolations catholiques tardives. Deuxièmement, Cyprien lui-même s'est violemment opposé au Pape Étienne Ier sur la question du baptême des hérétiques, ce qui prouverait qu'il ne reconnaissait pas sa juridiction suprême.
L'apologétique catholique répond à ces deux points :
- Le débat textuel : L'érudition patristique moderne, y compris non catholique, tend désormais à reconnaître que les deux versions du texte sont très probablement de la main de Cyprien lui-même. Mais plus important encore, même le "Texte Primitif" (préféré des critiques) maintient l'essentiel : le Christ a établi en Pierre l'"origine" et la "source" (origo) de l'unité, "pour manifester l'unité". Pour Cyprien, l'unité de l'épiscopat mondial découle de sa source, la Chaire de Pierre.
- La dispute avec le Pape Étienne : Ce conflit, loin de réfuter la primauté, la confirme d'une manière paradoxale. On ne dispute pas avec autant de véhémence (Cyprien convoquant des conciles africains pour s'opposer à Rome ) contre une autorité que l'on considère comme inexistante ou purement honoraire. Cyprien reconnaissait Rome comme la "Chaire de Pierre" et la "source de l'unité" , mais il estimait, à tort (comme l'histoire et l'Église l'ont jugé), que l'évêque Étienne errait dans une décision disciplinaire. Le conflit portait sur l'exercice de l'autorité primatiale, et non sur son existence.
Partie 3 : Le magistère et la définition infaillible du dogme
Les fondements posés dans l'Écriture et développés par la Tradition ont été précisés et définis dogmatiquement par le Magistère de l'Église, en particulier lors des deux derniers conciles œcuméniques.
3.1. Le premier concile du Vatican (1870) et la constitution Pastor Aeternus
Convoqué par le Pape Pie IX, le Concile Vatican I a défini solennellement deux aspects de la primauté pétrinienne dans sa constitution dogmatique Pastor Aeternus (18 juillet 1870).
La primauté de juridiction
Face aux théories gallicanes et conciliaristes qui cherchaient à limiter le pouvoir du Pape, le Concile a défini que le Pontife Romain, en tant que successeur de Pierre, possède une véritable primauté de juridiction sur toute l'Église. Le canon du chapitre 3 déclare :
« Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’une charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l’Église... ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu’il soit anathème. ».
Le magistère infaillible
Le chapitre 4 définit l'infaillibilité pontificale. Celle-ci n'est pas une "impeccabilité" (le Pape n'est pas sans péché) ni une inspiration divine (le Pape ne reçoit pas de nouvelles révélations ). L'infaillibilité est la conséquence logique de la primauté. Si le Pape a le devoir divin d'accomplir la mission de Lc 22 ("affermis tes frères") et d'être le garant de l'unité de la foi , il doit jouir de l'assistance divine de l'Esprit Saint pour que, dans un acte définitif, il ne puisse pas lier l'Église universelle à l'erreur.
Vatican I a donc défini que le Pape est infaillible, mais seulement lorsque des conditions très strictes sont remplies :
- Il doit parler ex cathedra, c'est-à-dire « en remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens ».
- Il doit engager sa « suprême autorité apostolique ».
- Il doit « définir » une doctrine (et non simplement exhorter ou donner son avis).
- La doctrine doit concerner « la foi ou les mœurs ».
- Elle doit être « à tenir par l’Église universelle ».
Le Concile a ajouté une clause cruciale : ces définitions sont « irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église » (ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae). Cette phrase condamne l'idée que le Pape aurait besoin de la ratification d'un concile ou de l'épiscopat pour qu'une de ses définitions soit valide.
3.2. Le second concile du Vatican (1962-1965) et la constitution Lumen Gentium
Certains ont cru à tort que le Concile Vatican II avait "corrigé" ou "affaibli" la doctrine de Vatican I. C'est le contraire qui est vrai : Vatican II a confirmé Vatican I et l'a intégré dans une ecclésiologie de communion plus complète.
La constitution Lumen Gentium a mis en lumière la doctrine de la "collégialité épiscopale" : le collège des évêques, uni à sa tête, le Pape, est lui aussi sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église. Cependant, le Concile précise immédiatement que ce pouvoir ne peut jamais s'exercer sans le consentement du Pontife romain : le collège agit "conjointement avec le Pontife romain, son chef, et jamais sans ce chef".
Vatican II réaffirme donc avec force la doctrine de Vatican I, rappelant que le Pape est le « principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité ». La primauté n'est pas une force extérieure s'opposant au collège des évêques, mais un office institué par le Christ au sein du collège, en tant que sa tête constitutive.
Partie 4 : Apologétique et dialogue : réponses aux objections courantes
La doctrine de la primauté de juridiction reste un point de division majeur dans le dialogue œcuménique. L'apologétique catholique doit y répondre avec clarté et charité.
4.1. Réponse à l'interprétation orthodoxe (La primauté d'honneur)
L'objection : L'Église orthodoxe, s'appuyant sur l'ecclésiologie des premiers siècles et la structure de la "Pentarchie" (les cinq grands patriarcats : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem), reconnaît à l'évêque de Rome une "primauté d'honneur" en tant que primus inter pares (premier parmi ses pairs). Elle rejette cependant toute "primauté de juridiction" universelle, la considérant comme une innovation tardive.
La réponse catholique :
- Insuffisance scripturaire : Comme démontré en Partie 1, les charges confiées par le Christ à Pierre (les clés du royaume, le pouvoir d'affermir ses frères, le pastorat universel) décrivent des actes d'autorité et de gouvernement, et non un simple honneur cérémoniel.
- Témoignage patristique : L'intervention de Clément à Corinthe , la norme doctrinale d'Irénée , et le concept de "source de l'unité" chez Cyprien attestent d'une conscience de l'autorité romaine qui dépasse largement la simple préséance.
- La leçon de l'histoire : L'unité de l'Église, voulue par le Christ, requiert un centre de communion visible doté d'une autorité ultime pour trancher les débats. La structure de la "Pentarchie" était elle-même une adaptation organisationnelle, et l'histoire a montré que le modèle du primus inter pares sans juridiction peine à maintenir une unité doctrinale et canonique universelle face aux crises majeures. La primauté de juridiction, en revanche, est la garantie institutionnelle de l'unité.
4.2. Réponse aux interprétations protestantes (La pierre et les clés)
Objection 1 : "La pierre, c'est la foi de Pierre, pas Pierre lui-même."
- Réponse : Réfuté en 1.1. C'est une fausse dichotomie. La fonction est donnée à la personne de Pierre en raison de sa foi divinement inspirée. Le nom "Pierre" (Roc) lui est donné personnellement.
Objection 2 : "Le pouvoir de lier et délier est donné à tous les apôtres en Mt 18, 18."
- Réponse : L'Église catholique ne le nie absolument pas. La différence est cruciale et réside dans la manière dont ce pouvoir est donné :
- Dans
Mt 16, Pierre reçoit ce pouvoir individuellement, personnellement, et en premier. Il reçoit également les clés du royaume, que les autres apôtres ne reçoivent jamais. - Dans
Mt 18, les apôtres reçoivent ce pouvoir collectivement, en tant que collège. - La structure de l'Église est donc à la fois collégiale et primatiale. Le collège des apôtres exerce son autorité, mais toujours en communion avec Pierre et, en dernière instance, sous l'autorité des clés qu'il détient seul.
Objection 3 : "La primauté était une charge pour Pierre seul et n'est pas transmissible."
- Réponse : Cette objection contredit la promesse même du Christ. L'Église est destinée à perdurer jusqu'à la fin des temps : « la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle ». Si l'Église (le "bâtiment") est perpétuelle, son "fondement" (l'office de Pierre) doit l'être aussi. Un fondement qui disparaît à la mort de Pierre ferait s'effondrer l'édifice. L'office de Pierre (la papauté) est donc, par la volonté du Christ, aussi permanent que l'Église elle-même. La Tradition, dès Clément de Rome, atteste de la conscience de cette succession.
Conclusion : Le "serviteur des serviteurs de Dieu"
La primauté de Pierre, loin d'être un privilège de puissance mondaine, est une charge redoutable au service de l'unité. Le titre le plus juste du Pape, "serviteur des serviteurs de Dieu", exprime la nature de ce "ministère pétrinien".
Le Pape n'est pas un monarque absolu. Il est le premier gardien de la foi, le garant de l'obéissance à la Parole de Dieu. Comme l'enseigne Vatican I, l'Esprit Saint n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils enseignent une nouvelle doctrine, mais pour qu'« avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi ». Le Pape est au service de la Parole, et non au-dessus d'elle.
Dans son encyclique Ut unum sint (1995), le Pape Jean-Paul II a reconnu que la papauté, dans sa forme historique, est devenue un obstacle à l'unité pour beaucoup de chrétiens non catholiques. Il a lancé une invitation historique aux autres Églises pour un dialogue fraternel sur les formes d'exercice de la primauté qui pourraient, à l'avenir, redevenir un "service de l'unité" reconnu par tous.
En fin de compte, la foi catholique tient que la primauté est un don du Christ à son Église. Le Seigneur a choisi un homme faible, Pierre, qui l'a renié, et l'a établi comme le Roc, afin qu'il soit toujours « évident que la victoire n'appartient qu'au Christ et n'est pas la conséquence des forces humaines ». C'est sur cette promesse divine, et non sur les mérites des hommes, que repose l'Église, unie visiblement autour du successeur de Pierre, jusqu'au retour du Seigneur.
Articles similaires

Un argument logique pour la papauté

Mais Dieu seul peut pardonner les péchés!

Qu’est-il arrivé à Jésus pendant les 3 jours où il était mort?

Dieu est-il une idée stupide? (dialogue socratique)

26 avril 2015 - Quatrième dimanche de Pâques

Un voyage au cœur de la foi catholique
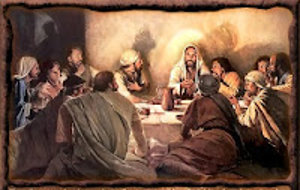
Pour que ta Foi ne défaille pas

5 mythes sur la papauté que trop de gens croient encore

« La pierre » de Matthieu 16,18 est-elle saint Pierre? Ou sa profession de foi?

Le Sédévacantisme

La croix et le purgatoire

Les preuves de la résurrection du Seigneur : fondement de la foi chrétienne

Troisième dimanche du Carême
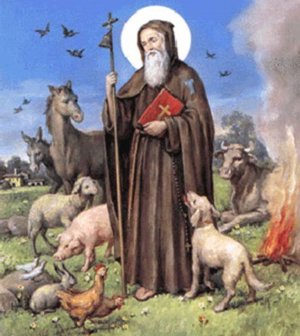
Fête de Saint Antoine le Grand: 17 janvier
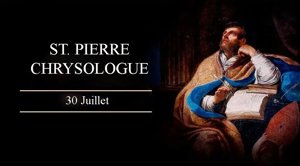
Saint Pierre Chrysologue: 30 juillet
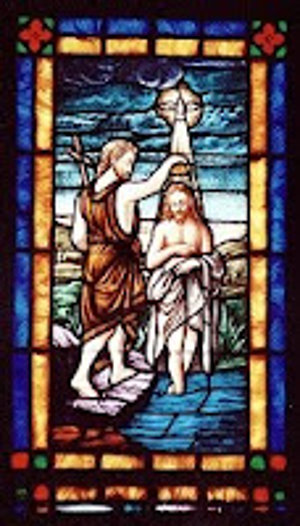
Passage de la Bible : le Baptême

Saint Pierre Claver: 9 septembre
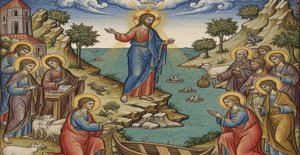
L'Église : Institution divine voulue par le Christ

Un guide pour naviguer les grandes questions de la foi