
Science et Foi : Les Deux Ailes de la Vérité

Introduction : Dépasser le mythe du conflit
Au seuil de son encyclique Fides et Ratio, le pape saint Jean-Paul II offre une image saisissante qui servira de fil conducteur à notre réflexion : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité ». Cette métaphore ne constitue pas une simple figure de style, mais bien le cœur de la pensée catholique sur la relation entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse. Elle propose une vision d'harmonie, de complémentarité et de finalité commune, diamétralement opposée au récit culturel dominant qui dépeint un conflit irréductible entre la science et la foi.
Ce récit conflictuel, souvent illustré par une caricature de l'affaire Galilée ou une lecture fondamentaliste du livre de la Genèse, a engendré un profond désarroi intellectuel et spirituel. Il place l'homme moderne devant un choix impossible : la raison sans la foi, qui risque de sombrer dans un matérialisme réducteur incapable de répondre aux questions ultimes sur le sens de l'existence ; ou la foi sans la raison, qui peut dériver vers le fidéisme et la superstition. Face à cette « tentation du désespoir » qui naît lorsque la raison abandonne la quête de la vérité ultime, l'Église se présente comme « l'avocate de la raison ».
L'objectif de cet article est de déconstruire ce mythe du conflit. En explorant les fondements théologiques de cette alliance, en revisitant l'histoire avec nuance, en dialoguant avec les découvertes de la science contemporaine et en présentant le témoignage lumineux de grands savants catholiques, nous montrerons que non seulement la foi et la science ne s'opposent pas, mais qu'elles sont les partenaires indispensables d'une même quête : la recherche de la Vérité, qui trouve sa source unique en Dieu. La séparation de ces deux ailes ne mène pas à une plus grande liberté, mais à un vol infirme, incapable d'atteindre les sommets de la connaissance. La synthèse catholique, loin d'être un compromis timide, est une proposition audacieuse pour une vision plus complète, plus cohérente et, ultimement, plus humaine de la réalité.
Partie I : Les fondements d'une alliance : la raison illuminée par la foi
La conviction de l'Église catholique en l'harmonie fondamentale entre science et foi ne repose pas sur un simple désir de conciliation, mais sur un principe théologique et philosophique inébranlable. Le Catéchisme de l'Église Catholique l'énonce avec une clarté lapidaire en son paragraphe 159 : « Bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles ». Toute contradiction apparente ne peut donc provenir que d'une double erreur : soit une mauvaise compréhension de la foi, soit une extrapolation illégitime de la science.
La raison de cette impossibilité de conflit est simple et profonde : la Vérité est une, car sa source est unique. Comme le précise le Compendium du Catéchisme, cette harmonie existe « parce que l'une et l'autre ont Dieu pour origine ». Dieu est le créateur de l'univers visible, dont les lois et les mécanismes sont étudiés par les sciences (la vérité naturelle), et Il est également l'auteur de la Révélation, dont le contenu est accueilli par la foi (la vérité surnaturelle). Puisque Dieu ne peut se contredire, les deux "livres" qu'Il a écrits – le livre de la nature et le livre de l'Écriture – ne peuvent, s'ils sont correctement lus, se contredire.
Loin d'être un saut aveugle dans l'irrationnel, l'acte de foi est lui-même un acte éminemment humain et raisonnable. Le Catéchisme le définit comme « un acte de l'intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce ». L'intelligence est donc au cœur de la foi. Elle examine les motifs de crédibilité de la Révélation – les miracles, les prophéties, la cohérence du message, la sainteté de l'Église – avant de donner son assentiment libre.
Cette vision permet de distinguer clairement les domaines de compétence de chaque discipline sans les opposer. La science, par la méthode expérimentale, cherche à répondre à la question du "comment" : comment l'univers fonctionne-t-il? Quelles sont les causes secondes qui régissent les phénomènes naturels? La foi et la théologie, quant à elles, s'intéressent au "pourquoi" ultime : pourquoi l'univers existe-t-il? Quelle est son origine première et sa finalité? Quel est le sens de l'existence humaine? Confondre ces deux ordres de questionnement est la source de la plupart des faux débats.
Plus encore, la relation n'est pas seulement de non-contradiction, mais d'enrichissement mutuel. La foi chrétienne, en affirmant que le monde a été créé par un Logos, un Dieu rationnel et bon, fournit le terreau philosophique indispensable à l'éclosion de la science. Elle postule un univers ordonné, intelligible et bon, digne d'être étudié par une raison humaine elle-même créée à l'image de Dieu. En retour, la raison purifie la foi de la superstition et lui fournit les outils conceptuels pour approfondir l'intelligence du mystère, selon le célèbre adage de saint Augustin, repris dans le Catéchisme : « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». La foi donne à la raison un horizon de sens qui la sauve du nihilisme, et la raison donne à la foi les instruments qui la protègent de l'irrationalité.
Partie II : L'Église, mère de la science occidentale
Le mythe d'une Église obscurantiste et ennemie du progrès intellectuel se heurte de plein fouet à la réalité historique. Loin d'avoir été un frein, l'Église catholique fut l'institution qui a créé les conditions culturelles, philosophiques et sociales nécessaires à la naissance de la science moderne en Europe.
Après la chute de l'Empire romain d'Occident, alors que les structures politiques et éducatives s'effondraient, ce sont les monastères qui devinrent les sanctuaires du savoir. Dans les scriptoria monastiques, des générations de moines ont patiemment copié et préservé non seulement les textes sacrés, mais aussi les œuvres des auteurs classiques grecs et latins, sauvant de l'oubli une part immense de l'héritage antique. Ces écoles monastiques, puis épiscopales, ont assuré la continuité de l'éducation en Occident pendant des siècles.
L'innovation la plus décisive fut sans doute la création de l'université au tournant du XIIIe siècle. Les grandes universités médiévales comme Paris, Bologne, Oxford ou Salamanque n'étaient pas des institutions laïques nées en opposition à l'Église. Elles sont une création directe de la chrétienté. Issues des écoles cathédrales, elles ont été fondées, dotées de chartes et protégées par l'autorité des papes. C'est le Saint-Siège qui leur a conféré leur statut international, leur autonomie face aux pouvoirs locaux (seigneurs et même évêques) et la reconnaissance universelle de leurs diplômes dans toute la chrétienté.
Le climat intellectuel de ces universités, dominé par la scolastique, est souvent caricaturé. En réalité, la méthode scolastique était un exercice d'une rigueur logique extrême, qui a aiguisé les outils de la raison et du débat argumenté. En cherchant à synthétiser la foi chrétienne et la philosophie d'Aristote redécouverte, des penseurs comme saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin ont promu l'idée d'un univers comme un système rationnel, régi par des lois naturelles, et accessible à l'investigation de la raison humaine. Cette conviction est la pierre angulaire de la démarche scientifique.
Ainsi, la révolution scientifique du XVIIe siècle, loin d'être une rupture radicale avec un "Moyen Âge ténébreux", en est en réalité l'héritière directe et le fruit mûr. Elle n'aurait pu voir le jour sans l'infrastructure institutionnelle (l'université) et le "logiciel" philosophique (la croyance en un cosmos ordonné et intelligible) patiemment mis en place par l'Église au cours des siècles précédents. L'idée même qu'un Galilée ou un Newton puissent exister et travailler est impensable sans ce long travail préparatoire mené au sein de la chrétienté.
Partie III : Démêler les mythes : relectures de l'histoire
Pour asseoir le récit du conflit, ses partisans s'appuient presque systématiquement sur deux dossiers emblématiques : l'affaire Galilée et l'interprétation de la Genèse. Une analyse sereine et documentée de ces deux cas permet non seulement de les dégonfler, mais aussi de révéler la cohérence de la pensée de l'Église sur les rapports entre les différents ordres de savoir.
L'affaire Galilée : la vérité derrière la caricature
Réduite à un simple combat entre la science éclairée et la religion dogmatique, l'affaire Galilée est en réalité d'une complexité historique, théologique et personnelle bien plus grande. Pour la comprendre, il faut la replacer dans son contexte : celui du début du XVIIe siècle, marqué par les déchirements de la Réforme protestante et la réaction de la Contre-Réforme catholique. Dans ce climat, l'interprétation de l'Écriture Sainte était devenue un enjeu doctrinal majeur, incitant les théologiens à une prudence et une rigueur accrues.
Le point central du différend n'était pas l'héliocentrisme en soi. L'Église n'avait jamais condamné le système de Nicolas Copernic, lui-même chanoine, qui le présentait comme une hypothèse mathématique commode pour les calculs. Le conflit a éclaté lorsque Galilée, fort de ses observations à la lunette, a voulu imposer l'héliocentrisme non plus comme une hypothèse, mais comme une vérité physique démontrée, exigeant que la théologie s'y conforme immédiatement. Or, à l'époque, il ne disposait pas de preuves irréfutables ; son argument principal, fondé sur les marées, s'est même révélé faux.
Des figures ecclésiastiques de premier plan, comme le cardinal Robert Bellarmin, étaient parfaitement au courant des enjeux scientifiques. Leur position n'était pas un refus borné de la science, mais l'application d'un principe théologique traditionnel : on ne doit pas modifier l'interprétation commune d'un passage de l'Écriture sans une preuve certaine qui l'exige. À cela se sont ajoutés des facteurs de politique ecclésiale, des rivalités académiques et le caractère parfois provocateur de Galilée lui-même, qui a transformé un débat scientifique en une épreuve de force institutionnelle.
La condamnation de 1633, bien que regrettable et reconnue comme une erreur par l'Église elle-même – notamment par la voix de Jean-Paul II en 1992 –, ne fut ni une condamnation à mort ni une séance de torture, mais une assignation à résidence dans ses confortables villas. L'affaire illustre moins un conflit essentiel entre foi et science qu'un tragique malentendu, où des théologiens ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur une question de science naturelle, et où un savant a manqué de prudence en exigeant une révolution théologique sur la base de preuves encore incomplètes.
Lire le livre de la Genèse : un message théologique, pas un manuel scientifique
L'autre grand point de friction supposé concerne les récits de la Création au début de la Genèse. Le fondamentalisme, qui lit ces textes comme un compte-rendu scientifique littéral, crée une opposition frontale avec la cosmologie et la biologie modernes. Or, cette approche est étrangère à la grande tradition d'interprétation catholique.
L'Église enseigne que la Bible dit la vérité, mais pas toujours à la manière d'un reportage journalistique ou d'un traité scientifique. Chaque texte doit être lu selon son genre littéraire. Les premiers chapitres de la Genèse ne sont ni de la science, ni de l'histoire au sens moderne, mais un texte d'une grande profondeur théologique, rédigé dans un langage poétique et symbolique pour transmettre des vérités fondamentales sur Dieu, l'homme et le monde.
Les vérités théologiques essentielles que ces récits nous enseignent sont les suivantes : l'univers a été créé à partir de rien (creatio ex nihilo) par un Dieu unique, bon et transcendant (ce qui était une affirmation révolutionnaire face aux mythes païens polythéistes et violents) ; la création est ordonnée, bonne et voulue par Dieu ; l'être humain est le sommet de cette création, créé « à l'image et à la ressemblance de Dieu » ; et le récit de la Chute explique l'origine du mal et de la souffrance dans le monde, non comme un défaut de la création, mais comme une conséquence de la liberté humaine.
Cette lecture non littéraliste n'est pas une concession récente faite sous la pression de la science. Dès le IVe siècle, saint Augustin d'Hippone, l'un des plus grands Pères de l'Église, mettait en garde les chrétiens contre une lecture naïve de la Genèse. Dans son traité De Genesi ad litteram ("Sur la Genèse au sens littéral"), il expliquait que les "six jours" de la création ne devaient pas être compris comme des jours de 24 heures, mais plutôt comme des catégories logiques, et que Dieu avait probablement créé le monde en un seul instant, sous la forme de "raisons séminales" ou de potentialités destinées à se déployer dans le temps. Cette approche patristique, d'une étonnante modernité, montre que la foi catholique a toujours possédé les outils intellectuels pour distinguer le message spirituel du texte de son habillage culturel et littéraire, rendant ainsi caduque toute opposition avec les découvertes scientifiques sur l'âge de l'univers ou l'évolution des espèces.
Partie IV : Le dialogue avec la science contemporaine
Loin de se replier sur elle-même, l'Église catholique a poursuivi et intensifié son dialogue avec la science aux XXe et XXIe siècles. Face aux deux grandes révolutions scientifiques que sont la cosmologie du Big Bang et la théorie de l'évolution, elle n'a pas manifesté de l'hostilité, mais un intérêt critique et un discernement théologique profond, trouvant même des points de convergence inattendus.
Du "Fiat Lux" au Big Bang : l'hypothèse de l'atome primitif
L'histoire de la théorie du Big Bang est intrinsèquement liée à la figure d'un prêtre catholique : Monseigneur Georges Lemaître. Ce physicien et astronome belge fut le premier, dans les années 1920, à formuler l'hypothèse d'un univers en expansion à partir d'un état initial extrêmement dense et chaud, qu'il nomma « l'hypothèse de l'atome primitif ». Il a ainsi posé les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui la cosmologie du Big Bang.
La vie de Lemaître est un témoignage éclatant de la possibilité de vivre une double vocation, scientifique et sacerdotale, sans schizophrénie. Il a toujours maintenu une distinction méthodologique claire entre ses deux domaines d'expertise. Pour lui, la science décrivait le "commencement" physique de l'univers, tandis que la théologie parlait de sa "création" métaphysique, c'est-à-dire de sa dépendance totale et continue à l'égard de Dieu. Un épisode célèbre illustre cette rigueur : en 1951, le pape Pie XII, dans un discours, fit un parallèle un peu trop direct entre la théorie de Lemaître et le Fiat Lux de la Genèse. Lemaître intervint respectueusement auprès du souverain pontife pour lui demander de ne pas faire de concordisme, soulignant que sa théorie était une hypothèse physique qui devait être jugée sur des critères scientifiques, et non théologiques. Le pape accepta la remarque et modifia ses discours ultérieurs, une preuve remarquable de la capacité de l'Église à respecter l'autonomie de la science.
Aujourd'hui, la position de l'Église est claire. Comme l'a affirmé le pape François, le Big Bang « n'est pas en contradiction avec l'intervention créative de Dieu, au contraire, il la nécessite ». En effet, une théorie scientifique qui postule un commencement temporel de l'univers pose avec encore plus d'acuité la question philosophique de sa cause première. La science décrit le déploiement de l'être, la foi affirme la source de cet être.
La théorie de l'évolution et le mystère de l'homme
De manière similaire, l'Église a progressivement accueilli la théorie de l'évolution comme une explication scientifique solide du développement de la vie sur Terre. Dès 1950, dans l'encyclique Humani generis, le pape Pie XII ouvrait la porte à la discussion, en précisant que le corps humain pouvait provenir d'une matière vivante préexistante. Le pas décisif fut franchi par saint Jean-Paul II qui, dans un discours à l'Académie pontificale des sciences en 1996, a affirmé que de nouvelles connaissances conduisaient à reconnaître dans la théorie de l'évolution « plus qu'une hypothèse ».
La clé de cette compatibilité réside dans une distinction fondamentale : l'Église accepte l'évolution comme processus biologique, mais rejette l'« évolutionnisme » comme idéologie matérialiste et réductionniste. Elle s'oppose à toute théorie qui prétendrait que l'esprit humain, la conscience, la liberté et l'âme ne sont qu'un simple produit émergent des forces de la matière vivante.
La doctrine catholique maintient une vérité théologique essentielle : si le corps de l'homme peut être le fruit d'un long processus évolutif, chaque âme spirituelle est, elle, créée immédiatement par Dieu. Il ne s'agit pas d'une intervention divine qui viendrait combler une "lacune" de la science (un "Dieu bouche-trou"), mais d'un acte créateur d'un autre ordre, ontologique, qui fonde la dignité unique de la personne humaine. Comme le dit le pape François, « l'évolution dans la nature n'est pas incompatible avec la notion de création, parce que l'évolution requiert la création de choses qui évoluent ». L'action créatrice de Dieu n'est pas un événement ponctuel dans le passé, mais un acte continu qui soutient l'existence et le dynamisme de tout l'univers, y compris les lois de l'évolution qu'Il a Lui-même établies.
Partie V : Une galerie de témoins : portraits de savants catholiques
Au-delà des principes théologiques et des débats historiques, la preuve la plus vivante de l'harmonie entre science et foi est incarnée par les vies de nombreux scientifiques qui ont uni une foi profonde à une excellence scientifique reconnue mondialement. Leurs parcours montrent concrètement comment les "deux ailes" peuvent coopérer pour porter l'esprit humain vers les plus hauts sommets.
Nicolas Copernic : Le chanoine qui a réorganisé le ciel
Loin de l'image du rebelle laïc en lutte contre l'Église, Nicolas Copernic (1473-1543) était un homme d'Église. Chanoine du chapitre de la cathédrale de Frauenburg, médecin, juriste et administrateur, il était un pur produit du système universitaire catholique de son temps. Son œuvre majeure, De revolutionibus orbium coelestium, qui proposait le modèle héliocentrique, ne fut pas un acte de défiance mais une quête de plus grande harmonie et d'élégance mathématique dans la compréhension de l'œuvre du Créateur. Conscient de l'audace de sa théorie, il dédia son livre au pape Paul III, se plaçant ainsi sous la protection de la plus haute autorité de l'Église.
Gregor Mendel : Le moine et les lois de l'hérédité
Le père de la génétique moderne, Gregor Mendel (1822-1884), était un moine augustin à l'abbaye Saint-Thomas de Brno. C'est dans le jardin de son monastère qu'il mena ses expériences méticuleuses sur l'hybridation des petits pois. Le cadre monastique lui offrit des conditions idéales pour sa recherche : la stabilité, la patience requise pour des observations sur plusieurs années, les ressources intellectuelles de la bibliothèque et le soutien de son abbé, lui-même intéressé par les questions d'hérédité. Son travail scientifique, d'une rigueur et d'une précision exceptionnelles, était une extension naturelle de sa contemplation de l'ordre et de l'intelligibilité déposés par Dieu dans la création.
Louis Pasteur : La foi au cœur du génie de la microbiologie
Louis Pasteur (1822-1895), l'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité, était animé par ce que ses biographes appellent une « foi du cœur ». Bien qu'il ne fût pas un pratiquant ostentatoire, sa vision du monde était profondément imprégnée de sa foi catholique. Cette foi a nourri son immense travail, motivé par un désir ardent de soulager la souffrance humaine, qu'il s'agisse de sauver les industries du vin et de la soie ou de développer les vaccins contre le choléra des poules, l'anthrax et la rage. La célèbre citation, qui lui est souvent attribuée, résume parfaitement sa pensée : « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène ». Pour Pasteur, plus il pénétrait les mystères de la nature, plus son admiration pour l'œuvre du Créateur grandissait.
Jérôme Lejeune : La science au service de la dignité de la vie humaine
Le professeur Jérôme Lejeune (1926-1994) est le témoin par excellence de l'articulation entre science, foi et morale au XXe siècle. Ce grand généticien, découvreur de l'anomalie chromosomique à l'origine de la trisomie 21, était un catholique fervent. Sa foi ne l'a pas seulement inspiré dans sa recherche, elle a dicté sa conduite morale lorsque sa propre découverte a commencé à être utilisée pour le dépistage prénatal en vue de l'avortement. Considérant chaque vie humaine, même la plus fragile, comme un don sacré de Dieu, il a consacré le reste de sa vie à défendre ses « petits patients ». Il est devenu une voix internationale pour la défense de la vie, au prix de sa carrière et, probablement, du prix Nobel. Sa vie montre de manière éclatante que pour le savant catholique, la recherche de la vérité scientifique (le fait que la vie humaine commence à la conception) est inséparable de l'impératif moral de la charité (protéger cette vie). L'Église l'a reconnu vénérable en 2021, le proposant comme un modèle pour les scientifiques d'aujourd'hui.
Tableau 1 : Autres figures marquantes de la science et de la foi catholique
Ces portraits ne sont que quelques exemples d'une longue et riche tradition. Le tableau suivant présente d'autres figures illustrant la contribution continue des catholiques, clercs et laïcs, au progrès scientifique à travers les âges.
| Nom du savant | Affiliation/Titre | Époque | Domaine scientifique | Contribution majeure |
| Saint Albert le Grand | Frère Dominicain, Évêque | XIIIe s. | Biologie, Chimie, Philosophie | Pionnier de la méthode expérimentale, naturaliste. |
| Roger Bacon | Frère Franciscain | XIIIe s. | Optique, Alchimie | Promoteur de la science expérimentale. |
| Christophe Clavius | Prêtre Jésuite | XVIe-XVIIe s. | Astronomie, Mathématiques | Architecte principal du calendrier grégorien. |
| Nicolas Sténon | Évêque | XVIIe s. | Géologie, Anatomie | Père de la stratigraphie et de la cristallographie. |
| Lazzaro Spallanzani | Prêtre | XVIIIe s. | Biologie, Physiologie | Réfutation de la génération spontanée, digestion. |
| André-Marie Ampère | Laïc | XIXe s. | Physique | Père de l'électrodynamique. |
| Angelo Secchi | Prêtre Jésuite | XIXe s. | Astrophysique | Pionnier de la spectroscopie stellaire. |
| Laura Bassi | Laïque | XVIIIe s. | Physique | Première femme professeur de physique dans une université. |
| Maria Gaetana Agnesi | Laïque | XVIIIe s. | Mathématiques | Mathématicienne, auteur de manuels de calcul. |
Export to Sheets
Conclusion : Une harmonie à redécouvrir et à vivre
Au terme de ce parcours, l'image initiale de saint Jean-Paul II prend toute sa force. La foi et la raison ne sont pas des forces antagonistes condamnées à une lutte perpétuelle, mais bien les deux ailes indispensables à l'esprit humain dans sa quête de vérité. Nous avons vu que cette conviction est ancrée dans les fondements théologiques de la foi catholique, qui voit en Dieu l'unique source de toute vérité, qu'elle soit naturelle ou révélée. L'histoire témoigne que l'Église, loin d'être un obstacle, a été la matrice qui a donné naissance à la science occidentale en créant l'université. Les mythes tenaces, comme ceux entourant Galilée ou la Genèse, se dissipent à la lumière d'une analyse rigoureuse, révélant des débats complexes plutôt qu'un conflit simpliste. Le dialogue fécond avec la cosmologie du Big Bang et la théorie de l'évolution montre une Église capable d'intégrer les découvertes modernes sans renier ses dogmes. Enfin, la vie de savants comme Copernic, Mendel, Pasteur et Lejeune prouve par l'exemple que la sainteté et le génie scientifique peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement.
Le récit du conflit est une simplification qui appauvrit à la fois la science et la foi. Il prive la science de son horizon métaphysique, la laissant muette face aux questions essentielles du sens et de la finalité. Il ampute la foi de sa dimension rationnelle, la réduisant à un sentiment subjectif. La tradition intellectuelle catholique offre un cadre plus robuste, plus cohérent et plus porteur d'espérance.
Redécouvrir et vivre cette harmonie n'est pas un simple exercice académique. C'est un appel à adopter une vision intégrale de la connaissance et de l'existence. C'est pouvoir contempler l'univers avec la rigueur de l'esprit scientifique et, simultanément, avec l'émerveillement et la gratitude du cœur croyant. C'est la réponse la plus sûre au « sommeil de la raison » qui, comme le prévenait Goya et le rappelait l'encyclique Fides et Ratio, « produit des monstres ». En déployant ensemble les deux ailes de la foi et de la raison, l'homme peut espérer s'élever vers la contemplation de cette Vérité qui, seule, le rend pleinement libre.
Articles similaires

La logique du baptême
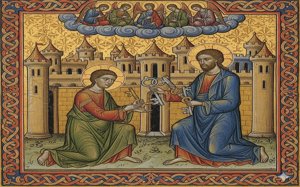
La primauté de Pierre : fondement de l'unité voulue par le Christ
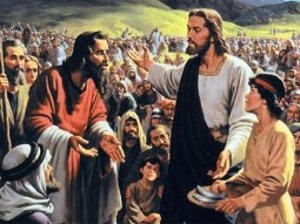
Des harmonies cachées dans les Évangiles

Fête de saint Jean de Capistran : 23 octobre

Les Indices pensables: 7- La dignité de la raison humaine.

Saint Étienne de Hongrie: 16 aout

Le Concile de Constantinople I (381) : La confirmation de la doctrine de la Trinité

Pour la défense du baptême des enfants

Le Concile Vatican I (1869-1870) : Définition de l'infaillibilité pontificale et réponse au monde moderne

Fête de Sainte Catherine de Sienne: 29 avril
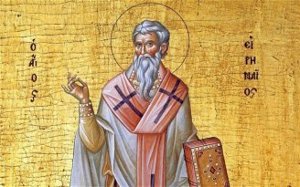
Fête de Saint Irénée de Lyon: 28 juin

Le Concile de Constantinople III (680-681) : La condamnation du monothélisme et l'affirmation des deux volontés du Christ
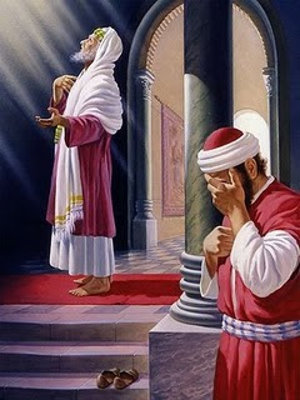
La foi et les œuvres

« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie

L'entrainement spirituel

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique : Les quatre signes de la véritable Épouse du Christ
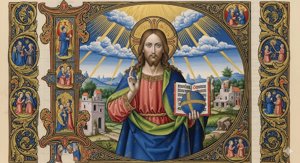
Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ

Fête de Sainte Marguerite D'Écosse: 16 novembre
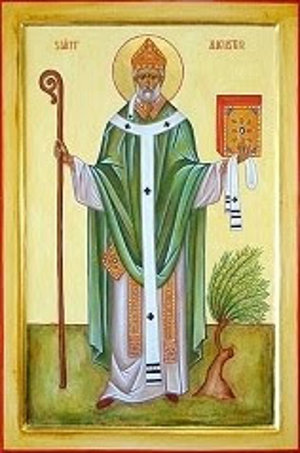
La Foi et les œuvres selon Saint-Augustin
