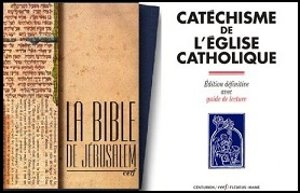La fiabilité des textes de la Bible : une enquête entre foi, histoire et raison

Introduction : Poser les justes questions
La question de la fiabilité de la Bible est au cœur de la foi chrétienne. Pour le croyant comme pour celui qui cherche, elle est incontournable. Mais que signifie exactement « fiable »? Dans une perspective catholique, la fiabilité des Écritures ne se résume pas à une inerrance littéraliste qui ignorerait les genres littéraires ou les contextes culturels antiques. Elle désigne plutôt la confiance fondamentale que les textes sacrés, inspirés par Dieu, transmettent sans erreur la vérité nécessaire à notre salut. La fiabilité est donc une réalité à plusieurs dimensions : elle est à la fois textuelle, historique et théologique.
L'approche catholique, loin de craindre la raison, l'embrasse. Elle ne demande pas une foi aveugle, mais une foi qui cherche à comprendre, selon la célèbre formule de saint Anselme, Fides quaerens intellectum (la foi cherchant l'intelligence). Elle utilise donc les outils de la critique textuelle, de l'histoire et de l'archéologie pour sonder les fondements de la Révélation divine. Cette harmonie entre foi et raison trouve une expression magistrale dans la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum, qui affirme que Dieu se révèle à travers des actes et des paroles intimement liés.
Cet article se propose d'explorer trois grandes dimensions de la fiabilité biblique. Nous examinerons d'abord la solidité de la transmission de ses textes à travers les siècles. Nous sonderons ensuite la robustesse de ses fondements historiques, en la confrontant aux découvertes archéologiques et aux témoignages profanes. Enfin, nous aborderons sa fiabilité théologique en tant que Parole de Dieu, discernée et confiée à l'Église pour être interprétée authentiquement.
Partie 1 : La transmission des textes : un miracle de conservation
Avant même de se demander si le contenu de la Bible est vrai, une question préalable se pose : les textes que nous lisons aujourd'hui sont-ils les mêmes que ceux qui furent écrits il y a deux ou trois millénaires? À une époque où la copie était manuelle et les supports fragiles, la conservation fidèle d'un texte sur une si longue période est en soi un défi majeur. L'examen des manuscrits bibliques révèle une histoire de transmission d'une richesse et d'une rigueur sans équivalent dans le monde antique.
La mémoire d'Israël : la transmission de l'Ancien Testament
La transmission de l'Ancien Testament s'appuie principalement sur deux grands témoins textuels, dont la confrontation a été éclairée de manière spectaculaire par l'archéologie au XXe siècle.
Le premier témoin est le Texte Massorétique (TM). Il s'agit du texte hébreu traditionnel, tel qu'il a été méticuleusement copié et préservé par des générations de scribes juifs, les Massorètes, entre les VIe et Xe siècles de notre ère. Leur travail ne consistait pas à modifier le texte, mais à fixer et préserver la tradition de lecture (massorah) en ajoutant un système de points-voyelles et d'accents au texte consonantique qui existait auparavant. Le plus ancien manuscrit complet de cette tradition est le Codex de Leningrad, daté d'environ 1008 apr. J.-C..
Le second témoin majeur est la Septante (LXX). C'est la traduction grecque de la Bible hébraïque, initiée au IIIe siècle av. J.-C. à Alexandrie pour les besoins de la communauté juive hellénophone. Son importance est capitale car elle est plus ancienne que la forme finale et vocalisée du Texte Massorétique. Elle nous donne donc accès à un état du texte hébreu antérieur à la standardisation qui a abouti au TM, un texte datant de l'époque du Second Temple.
Pendant des siècles, les biblistes ont travaillé avec ces deux traditions, notant leurs similitudes mais aussi leurs différences. La découverte des manuscrits de la mer Morte entre 1946 et 1956 a provoqué une véritable révolution. Datant d'une période allant du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle apr. J.-C., ces rouleaux ont fait reculer notre connaissance directe du texte hébreu de plus de mille ans. Dans les grottes de Qumrân, on a retrouvé des fragments de tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther.
Ces découvertes ont apporté une double confirmation. D'une part, elles ont attesté de l'extraordinaire fidélité de la tradition des scribes. Le Grand Rouleau d'Isaïe, par exemple, datant du IIe siècle av. J.-C., est quasi identique au texte du même livre dans le Codex de Leningrad, copié plus de 1000 ans plus tard. D'autre part, les manuscrits ont révélé ce que les spécialistes appellent une « diversité textuelle ». Certains fragments de Qumrân sont plus proches du texte hébreu qui a servi de base à la Septante ou au Pentateuque Samaritain que du Texte Massorétique. Cela démontre qu'avant une certaine standardisation du texte par le judaïsme rabbinique vers la fin du Ier siècle apr. J.-C., plusieurs traditions textuelles hébraïques, très proches mais avec des variantes, coexistaient.
Cette complexité textuelle, loin d'être une menace, vient en réalité renforcer la vision catholique de la Révélation. Le modèle de la foi catholique, tel qu'il est articulé dans la constitution Dei Verbum, ne présente pas la Bible comme un livre dicté mécaniquement par Dieu et tombé du ciel. Il la voit comme le fruit d'une Révélation qui se déploie dans l'histoire d'un peuple, Israël, puis de l'Église. Cette Révélation est d'abord portée par une « Sainte Tradition » vivante avant d'être consignée par écrit. La diversité textuelle observée à Qumrân n'est donc pas un problème, mais plutôt une confirmation archéologique de ce modèle. Elle montre que la Parole de Dieu a été méditée, transmise et vécue au sein de la communauté croyante (la Tradition) avant d'être fixée dans une forme canonique définitive. La fiabilité ne réside pas dans une uniformité textuelle mécanique depuis l'origine, mais dans le fait que l'Esprit Saint a guidé ce processus vivant pour nous transmettre fidèlement le message du salut.
Le Nouveau Testament : une richesse manuscrite sans équivalent dans l'Antiquité
Si la transmission de l'Ancien Testament est impressionnante, celle du Nouveau Testament est tout simplement stupéfiante et sans parallèle dans toute la littérature antique.
Nous possédons aujourd'hui environ 5 700 manuscrits grecs complets ou partiels du Nouveau Testament. Si l'on ajoute les anciennes traductions en d'autres langues (latin, syriaque, copte, etc.), ce chiffre dépasse les 25 000. Cette masse documentaire exceptionnelle permet aux spécialistes de la critique textuelle, en comparant les manuscrits, de reconstruire le texte original avec un degré de certitude extrêmement élevé.
Plus important encore est la proximité chronologique entre la rédaction des originaux (entre 50 et 100 apr. J.-C.) et nos plus anciennes copies. Le plus ancien fragment connu, le Papyrus P52, qui contient un passage de l'Évangile selon saint Jean (Jn 18, 31-33.37-38), est daté d'environ 125 apr. J.-C., soit à peine une génération après la mort de l'apôtre. De nombreux autres papyrus datent des IIe et IIIe siècles, et nous possédons des Bibles quasi complètes, comme le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, datant du IVe siècle.
Face à un si grand nombre de copies manuelles, l'existence de variantes est inévitable et cela peut paraître alarmant, mais il doit être relativisé. L'immense majorité de ces variantes sont des erreurs bénignes : fautes d'orthographe, inversions de mots qui ne changent pas le sens, etc. Moins de 1% des variantes sont à la fois significatives (elles affectent le sens) et viables (elles pourraient faire partie du texte original). Surtout, aucune de ces variantes ne remet en cause une seule doctrine fondamentale de la foi chrétienne.
La meilleure façon d'apprécier ce trésor manuscrit est de le comparer à d'autres œuvres de l'Antiquité, dont l'authenticité n'est remise en cause par aucun historien sérieux.
| Auteur | Œuvre | Rédigé (approx.) | Plus ancienne copie (approx.) | Écart temporel | Nbre de copies |
| Apôtres et disciples de Jésus | Nouveau Testament | 50-100 apr. J.-C. | 125 apr. J.-C. (P52) | ~ 50 ans | ~ 5 700 (grec) |
| Homère | Iliade | 800 av. J.-C. | 11e s. apr. J.-C. | ~ 1 900 ans | ~ 650 |
| Platon | Tétralogies | 400 av. J.-C. | 9e s. apr. J.-C. | ~ 1 300 ans | ~ 7 |
| César | Guerre des Gaules | 50 av. J.-C. | 900 apr. J.-C. | ~ 950 ans | ~ 10 |
| Tacite | Annales | 100 apr. J.-C. | 9e s. apr. J.-C. | ~ 800 ans | 1 (pour livres 1-6) |
Ce tableau rend l'évidence visuelle. L'objection courante du « téléphone arabe », selon laquelle le texte aurait été corrompu au fil des copies, s'effondre face aux données. Si nous appliquons les mêmes critères de critique historique à tous les textes de l'Antiquité, le Nouveau Testament n'est pas seulement fiable, il est le texte le mieux attesté de loin. La question n'est donc plus de savoir si nous possédons le bon texte, mais de savoir si le texte que nous possédons est vrai.
Partie 2 : Les fondements historiques : la Bible à l'épreuve des faits
La Bible n'est pas un recueil de mythes intemporels ou de fables morales. Elle se présente comme le récit d'une intervention de Dieu dans l'histoire concrète des hommes. De l'appel d'Abraham à la Résurrection de Jésus, les événements qu'elle relate sont ancrés dans des lieux, des époques et des cultures précises. Il est donc légitime de la soumettre à l'épreuve des faits, en la confrontant aux autres sources dont nous disposons sur le passé.
Quand les pierres crient : ce que l'archéologie nous apprend
L'archéologie ne peut pas « prouver » la foi ou l'inspiration divine d'un texte. Une pierre ne peut pas nous dire si Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, elle peut confirmer ou infirmer le cadre historique dans lequel les récits bibliques se déroulent, leur conférant une plausibilité tangible. Au cours des deux derniers siècles, les découvertes archéologiques ont massivement corroboré l'arrière-plan historique de la Bible.
Pour l'Ancien Testament, les exemples sont nombreux. Pendant longtemps, les critiques ont considéré les Hittites, mentionnés une cinquantaine de fois dans la Bible, comme un peuple légendaire. Or, les fouilles menées en Turquie au début du XXe siècle ont mis au jour les archives et la capitale de ce puissant empire. En 1993, la découverte à Tel Dan, en Israël, d'une stèle du IXe siècle av. J.-C. mentionnant la « Maison de David » a fourni la première preuve extra-biblique de l'existence de la dynastie fondée par le roi David. De même, des découvertes comme le tunnel creusé par le roi Ézéchias sous Jérusalem (mentionné en 2 Rois 20, 20) ou des tablettes babyloniennes confirmant l'existence du roi Belschazzar (Daniel 5) ancrent fermement le récit biblique dans une réalité historique vérifiable.
Pour le Nouveau Testament, les confirmations sont tout aussi frappantes. Des lieux décrits avec précision par les évangélistes, comme la piscine de Bethesda à cinq portiques (Jn 5, 1-14) ou le réservoir de Siloé (Jn 9, 1-4), ont été mis au jour à Jérusalem. À Corinthe, les archéologues ont dégagé le tribunal (bema) où l'apôtre Paul a comparu devant le proconsul Gallion, un événement daté avec précision par les historiens (Actes 18, 12-17). L'historien Sir William Ramsay, initialement sceptique, s'est lancé dans une exploration de l'Asie Mineure pour réfuter l'historicité des Actes des Apôtres. Il en est revenu convaincu de l'exactitude scrupuleuse de saint Luc, notamment dans son usage des titres administratifs romains (proconsul, politarque, etc.), et a conclu que Luc devait être placé « parmi les historiens de premier rang ».
Il faut bien sûr rester prudent : l'absence de preuve archéologique n'est pas une preuve d'absence. Certains événements, comme le déplacement de populations nomades, laissent peu de traces matérielles, et le débat sur l'Exode, par exemple, reste ouvert parmi les spécialistes. Néanmoins, la tendance générale est claire : plus l'archéologie progresse, plus le monde de la Bible nous devient familier et plus le cadre de ses récits apparaît solide.
Les auteurs des Évangiles : témoins oculaires et proches des apôtres
Une idée reçue tenace voudrait que les Évangiles aient été écrits tardivement par des auteurs anonymes qui auraient ensuite usurpé le nom d'apôtres pour donner du crédit à leurs œuvres. Cette théorie est contredite par les preuves manuscrites et les témoignages historiques les plus anciens.
Premièrement, les Évangiles n'ont jamais circulé anonymement. Tous les manuscrits que nous possédons, y compris les plus anciens fragments du IIe siècle, portent les titres « Selon Matthieu », « Selon Marc », etc.. Deuxièmement, les témoignages de l'Église primitive sont unanimes et très précoces. Papias, évêque de Hiérapolis, écrivant vers 125 apr. J.-C. et se réclamant de la tradition de l'apôtre Jean, atteste que Marc a été « l'interprète de Pierre » et a retranscrit fidèlement sa prédication, et que Matthieu a rédigé les « oracles » (les paroles) du Seigneur en langue hébraïque. Vers 180, saint Irénée de Lyon, dont le maître Polycarpe avait été un disciple direct de Jean, confirme l'attribution des quatre Évangiles à Matthieu, Marc, Luc (le compagnon de Paul) et Jean. Ces témoignages sont corroborés par d'autres sources comme le Fragment de Muratori (c. 170) et Tertullien (c. 207).
L'attribution de deux des quatre Évangiles à des figures qui ne faisaient pas partie du cercle des Douze, Marc et Luc, constitue en soi un puissant argument en faveur de leur authenticité. Si l'Église primitive avait voulu inventer des auteurs pour légitimer des textes, la logique aurait commandé de choisir des noms prestigieux et incontestables comme Pierre, Thomas ou André. Attribuer un texte à « Marc, l'assistant de Pierre » ou à « Luc, le compagnon de voyage de Paul » est une stratégie de légitimation si peu évidente qu'elle en devient hautement crédible. La meilleure explication à la conservation de ces noms par la tradition est tout simplement qu'ils sont les véritables auteurs. Cet « embarras » apparent, le fait que tous les évangélistes ne soient pas des apôtres de premier plan, devient un critère d'authenticité historique. Personne n'aurait inventé une telle attribution.
Jésus et les premiers chrétiens vus par les historiens non-chrétiens
L'existence de Jésus de Nazareth n'est pas une simple question de foi ; c'est un fait historique établi, corroboré par plusieurs sources non-chrétiennes, souvent hostiles, qui confirment les grandes lignes du récit évangélique.
L'historien romain Tacite (c. 56-120), dans ses Annales (écrites vers 115), rapporte l'incendie de Rome sous Néron en 64. Pour détourner les soupçons, Néron accusa et fit supplicier les chrétiens. Tacite précise que ce nom leur venait de « Christ, qui, sous le principat de Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate ». En quelques lignes, cet auteur païen confirme le nom du fondateur, son titre messianique (Christ), son exécution, la date de celle-ci (sous Tibère et Pilate) et l'existence d'une communauté de disciples à Rome moins de 35 ans après l'événement.
L'historien juif Flavius Josèphe (c. 37-100), dans ses Antiquités Judaïques (c. 93), mentionne Jésus à deux reprises. Dans un passage incontesté, il évoque la lapidation de « Jacques, le frère de Jésus, que l'on appelle le Christ ». Un autre passage plus long, le Testimonium Flavianum, le décrit comme un « homme sage », auteur « d'œuvres prodigieuses », qui fut crucifié par Pilate et dont les disciples affirmèrent qu'il leur était apparu vivant. Si ce passage a probablement été retouché par des copistes chrétiens, la plupart des spécialistes s'accordent aujourd'hui sur l'existence d'un noyau authentique.
D'autres auteurs corroborent ces faits. Suétone (c. 120) mentionne l'expulsion de Rome des Juifs qui s'agitaient « à l'instigation d'un certain Chrestus ».
Pline le Jeune, gouverneur romain, dans une lettre à l'empereur Trajan (c. 112), décrit les chrétiens comme des gens qui se rassemblent pour « chanter un hymne au Christ comme à un dieu ». Même le
Talmud juif, dans ses passages polémiques, confirme indirectement des éléments clés : il nomme Jésus ("Yeshu"), mentionne sa crucifixion la veille de la Pâque et l'accuse de sorcellerie, ce qui est une manière hostile de reconnaître qu'il accomplissait des actes extraordinaires.
Ces sources externes, prises ensemble, dessinent un portrait de Jésus et du christianisme primitif qui s'accorde remarquablement avec celui des Évangiles.
Partie 3 : La fiabilité théologique : Parole de Dieu en paroles humaines
La fiabilité textuelle et historique de la Bible établit qu'elle est un document digne de confiance sur le plan humain. Mais pour le croyant, elle est bien plus : elle est la Parole de Dieu. Cette dimension de la fiabilité relève de la foi, mais d'une foi qui s'appuie sur le discernement de l'Église, guidée par l'Esprit Saint.
La formation du Canon : comment l'Église a discerné les Écritures
Le mot « canon » (du grec kanôn, la règle) désigne la liste des livres que l'Église reconnaît comme inspirés par Dieu et donc comme la norme de sa foi et de sa vie. Contrairement à une idée reçue, cette liste n'a pas été décrétée arbitrairement par un empereur ou un concile. Elle est le fruit d'un long processus de réception et de discernement au sein de la communauté croyante.
Les Églises locales, dès le premier siècle, lisaient lors de leurs assemblées liturgiques les lettres des apôtres et les récits de la vie de Jésus. Progressivement, un consensus s'est dégagé sur un noyau de textes reconnus partout comme ayant une autorité apostolique. Les critères de ce discernement étaient principalement au nombre de trois :
- L'origine apostolique : le livre avait-il été écrit par un apôtre ou un de ses proches collaborateurs?
- L'usage liturgique : le livre était-il lu universellement dans les Églises lors de la célébration de l'Eucharistie?
- La conformité avec la règle de la foi : son enseignement était-il en accord avec la doctrine fondamentale transmise oralement par les apôtres?
Dès le IIe siècle, des Pères comme saint Irénée reconnaissent l'autorité unique des quatre Évangiles. Le Canon de Muratori, un document romain daté d'environ 170, donne une liste de livres du Nouveau Testament déjà très proche de la nôtre.
Ce sont les conciles régionaux d'Hippone (393) et de Carthage (397), en Afrique du Nord, auxquels participa saint Augustin, qui furent les premiers à promulguer officiellement la liste complète des 27 livres du Nouveau Testament et des 46 livres de l'Ancien Testament (incluant les livres que les protestants nomment apocryphes et que les catholiques appellent deutérocanoniques). Ces conciles n'ont pas inventé le canon, mais ils ont ratifié et fixé une tradition déjà largement établie. Plus tard, face à la Réforme protestante qui rejetait les livres deutérocanoniques, le Concile de Trente (1546) a défini de manière dogmatique et infaillible ce même canon, confirmant solennellement la tradition constante de l'Église depuis ses origines.
Écriture, Tradition et Magistère : les trois piliers de la Révélation (Dei Verbum)
Pour comprendre la vision catholique de la Bible, la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II est un guide indispensable. Elle enseigne que la Révélation divine n'est pas d'abord un livre, mais la personne même de Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Cette Révélation nous est transmise par deux réalités intimement liés :
- La Sainte Écriture, qui est la Parole de Dieu mise par écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint.
- La Sainte Tradition, qui est la Parole de Dieu confiée par le Christ et l'Esprit aux apôtres, et transmise intégralement à leurs successeurs par la prédication, la liturgie, la prière et la vie de l'Église.
L'Écriture et la Tradition « jaillissent d'une même source divine, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à la même fin » (Dei Verbum, 9). Il est essentiel de comprendre que la Bible est née de la Tradition de l'Église ; elle n'est pas tombée du ciel pour que l'Église se forme à partir d'elle. C'est la communauté croyante qui, guidée par l'Esprit, a discerné quels écrits étaient l'expression authentique de la foi qu'elle avait reçue des apôtres.
La charge d'interpréter authentiquement cette Parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou transmise, a été confiée au seul Magistère vivant de l'Église (le Pape et les évêques en communion avec lui). Le Magistère n'est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais il est à son service, l'enseignant avec fidélité (Dei Verbum, 10). Écriture, Tradition et Magistère sont donc inséparables et se soutiennent mutuellement.
Répondre aux objections courantes
Cette vision de la Bible comme Parole de Dieu en paroles humaines, lue dans la Tradition et interprétée par le Magistère, permet de répondre sereinement à de nombreuses objections.
- Les contradictions apparentes : Beaucoup de prétendues contradictions se résolvent en appliquant des règles de lecture saines. Il faut tenir compte du genre littéraire (on ne lit pas un poème des Psaumes comme une chronique des Rois), du contexte historique et culturel, et de la perspective de l'auteur. Les quatre évangélistes ne sont pas des sténographes visant une uniformité plate ; ce sont des théologiens qui sélectionnent et organisent leur matériel pour mettre en lumière un aspect particulier du mystère du Christ. Leurs différences de détail, loin d'être des contradictions, témoignent de leur indépendance et renforcent leur crédibilité globale.
- La violence et les passages moralement difficiles : Il est crucial de comprendre la notion de pédagogie divine progressive. Dieu se révèle graduellement à un peuple à la « nuque raide », s'adaptant à sa culture et à sa compréhension pour le conduire pas à pas vers la plénitude de la Révélation en Jésus-Christ et son commandement d'amour. De plus, il faut distinguer ce que la Bible décrit (les actions des hommes, y compris leurs péchés) de ce que Dieu prescrit.
- La Bible et la science : L'Église catholique enseigne qu'il ne peut y avoir de véritable contradiction entre la foi et la science, car Dieu est l'unique source de toute vérité. Les conflits apparents naissent souvent d'une double erreur d'interprétation : lire la Bible comme un manuel de sciences naturelles, ou faire de la science une idéologie matérialiste qui nie toute réalité au-delà du mesurable. La Bible répond à la question du « Pourquoi? » (le sens de l'existence), la science à la question du « Comment? » (les mécanismes du monde physique).
Au cœur de toute l'apologétique chrétienne se trouve un événement qui sert de clé de voûte à la fiabilité de la Bible : la Résurrection de Jésus. L'argumentation n'est pas circulaire (« la Bible est vraie parce qu'elle le dit »). Elle suit plutôt une spirale ascendante. Les preuves textuelles et historiques externes nous donnent une confiance raisonnable dans les Évangiles comme documents historiques. Ces documents fiables convergent vers un événement central, historiquement défendable par des arguments solides : la mort de Jésus, la découverte de son tombeau vide, ses apparitions post-mortem et la transformation radicale de ses disciples, prêts à mourir pour ce qu'ils affirmaient avoir vu. Si la Résurrection est un événement historique plausible, elle constitue le sceau divin, le « témoignage du Père » qui valide la personne et les prétentions de Jésus. Or, ce même Jésus a traité les Écritures de l'Ancien Testament comme la Parole de Dieu faisant autorité, et il a conféré cette même autorité à ses apôtres pour fonder l'Église et produire le Nouveau Testament. La Résurrection est donc le pivot qui fait passer d'une fiabilité purement humaine et historique à une fiabilité divine et inspirée.
Conclusion : Une confiance raisonnable
La fiabilité de la Bible ne repose pas sur un argument unique et fragile, mais sur la convergence de multiples lignes de preuves. La solidité de sa transmission textuelle, qui surpasse de loin celle de toute autre œuvre de l'Antiquité, nous assure que nous lisons bien ce qui a été écrit. Les confirmations de l'archéologie et des historiens non-chrétiens ancrent son récit dans la réalité du monde. Le témoignage précoce et unanime de l'Église primitive sur ses auteurs nous relie directement aux témoins oculaires. Enfin, la cohérence de son message, qui culmine dans l'événement historiquement crédible de la Résurrection de Jésus-Christ, lui confère une autorité unique.
La foi catholique dans les Saintes Écritures n'est donc pas un saut dans le vide ou une adhésion irrationnelle. C'est un pas fondé sur des indices solides, un « assentiment raisonnable ». L'apologétique ne prétend pas contraindre l'intelligence par une preuve mathématique, mais elle montre que croire est une démarche profondément humaine et rationnelle.
Au-delà de son statut de document fiable, la Bible est une invitation à une rencontre. Car à travers ces mots humains, consignés et transmis fidèlement, c'est une Personne qui nous parle : Jésus-Christ, la Parole vivante et éternelle de Dieu. L'invitation finale est donc de la lire, de l'étudier, mais surtout de la prier au sein de l'Église, pour que cette Parole fiable devienne une Parole vivante et transformatrice dans nos vies.
Articles similaires

Les dogmes peuvent-ils se développer ?

La violence dans la Bible

À la découverte de Jésus et de la Bible

Les premiers chrétiens ont-ils cru aux miracles parce qu’ils vivaient dans une culture préscientifique et ignorante ?

Réflexions bibliques du 24 août 2014: Ô, profondeurs!
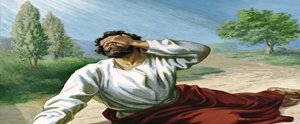
Difficulté biblique : Qu'est-il arrivé à la conversion de Paul?

Quelques réflexions sur Q

Réflexions bibliques du 13 juillet 2014: Le retour de la Parole

22 mars 2015 - Cinquième dimanche du Carême

Troisième dimanche du Carême

Réflexions bibliques du dimanche 1 juin 2014: Connaître Dieu

13 septembre 2015 : 24e dimanche du Temps Ordinaire

Réflexions bibliques du 7 septembre 2014: Pour les reconquérir

Pour la défense du baptême des enfants

Réflexions bibliques du dimanche 23 février 2014: Saint comme Dieu

Question d’un lecteur : La chaise du Pape avec la croix renversée est-elle un signe satanique?

Réflexions bibliques du 21 sepembre 2014: Les premiers et les derniers

Preuve par témoignage

Pourquoi les catholiques prient les saints?