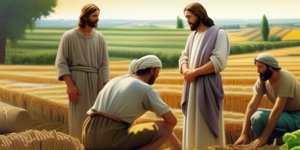L'argument moral : comment le bien nous mène à Dieu

Introduction : L'écho de la loi morale dans le cœur humain
Au cœur de l'expérience humaine se trouve un phénomène aussi universel qu'énigmatique : le jugement moral. Nous ne nous contentons pas d'observer le monde ; nous l'évaluons. Lorsque nous sommes témoins d'un acte de cruauté gratuite ou d'une trahison, notre réaction n'est pas une simple aversion esthétique, semblable à un dégoût pour un plat mal préparé. Nous ressentons une indignation profonde, une conviction que quelque chose a été violé. En s'exclamant « Ce n'est pas juste! », nous ne faisons pas que partager une opinion personnelle. Nous faisons appel à une norme de justice que nous croyons, intuitivement, être contraignante non seulement pour nous, mais aussi pour autrui. Cet appel instinctif à un étalon de mesure transcendant, à ce que l'écrivain et apologiste C.S. Lewis a brillamment nommé la « Loi de la Nature Humaine », constitue le point de départ de l'une des explorations les plus fascinantes de la philosophie et de la théologie : l'argument moral pour l'existence de Dieu.
Cet article se propose de démontrer que ce sens moral universel, lorsqu'il est examiné avec la rigueur de la raison, ne peut être réduit à une simple convention sociale, à un instinct biologique ou à une préférence subjective. Il se révèle être un indice profond, une « rumeur de sens » au sein de l'univers, qui pointe inexorablement vers l'existence d'un fondement transcendant pour le bien, une source objective de toute valeur. Cette conclusion, accessible à la raison naturelle, trouve son explication la plus cohérente et la plus satisfaisante au sein de la grande tradition intellectuelle et spirituelle catholique, qui a toujours affirmé l'harmonie entre la foi et la raison. Nous n'aborderons pas cet argument comme une preuve mathématique cherchant à contraindre l'assentiment, mais plutôt comme une puissante convergence d'indices qui fait de la foi en Dieu un engagement profondément raisonnable et éclairé.
La force singulière de l'argument moral réside dans son point de départ. Contrairement aux arguments cosmologiques, qui partent de l'existence du cosmos, ou aux arguments ontologiques, qui débutent par la définition de Dieu, l'argument moral commence par une donnée intime et indéniable de notre propre conscience. Il ne nous demande pas de contempler les galaxies lointaines, mais d'examiner l'architecture de notre propre âme et la nature de nos interactions les plus quotidiennes. Chaque fois que nous nous disputons, que nous cherchons une excuse, que nous ressentons de la culpabilité ou que nous admirons un acte de sacrifice, nous fournissons les données brutes pour cette enquête. Ce point de départ interne rend l'argument extraordinairement personnel et difficile à écarter comme une simple spéculation métaphysique. Rejeter ses prémisses revient à affirmer que nos intuitions les plus profondes concernant la justice, l'équité et le mal sont, en fin de compte, des illusions sans fondement, une conclusion aux conséquences existentielles considérables. L'argument moral nous confronte non pas d'abord à l'univers, mais à nous-mêmes, et nous invite à découvrir la condition de possibilité de notre propre vie morale.
La structure logique de l'argument moral
Pour naviguer avec clarté dans cette exploration, il est essentiel de présenter d'abord l'argument dans sa forme la plus rigoureuse et la plus courante : un syllogisme déductif. Cette structure logique, si ses prémisses sont vraies, mène inéluctablement à sa conclusion. Elle servira de feuille de route pour l'ensemble de notre analyse.
- Prémisse 1 : Si Dieu n'existe pas, les valeurs et devoirs moraux objectifs n'existent pas.
- Prémisse 2 : Or, les valeurs et devoirs moraux objectifs existent.
- Conclusion : Donc, Dieu existe.
La solidité de cette déduction dépend entièrement de la vérité de ses deux prémisses. Par conséquent, la tâche de l'apologiste est de défendre chacune d'elles. Mais avant cela, une définition méticuleuse du terme clé « objectif » est indispensable à l'intégrité de l'argument.
Une valeur ou un devoir moral est dit objectif s'il est vrai et contraignant indépendamment de ce que quiconque pense, ressent ou croit. Son opposé est le subjectif, qui dépend entièrement de l'opinion ou de la préférence d'un sujet. Pour illustrer, la proposition « la crème glacée à la vanille est meilleure que celle au chocolat » est subjective. Il n'y a pas de vérité de la question en dehors des préférences personnelles. En revanche, la proposition « le génocide est moralement mauvais » se présente comme une affirmation objective. L'argument soutient que l'Holocauste était objectivement et intrinsèquement mauvais, même si les nazis croyaient sincèrement agir pour le bien, et même s'ils avaient réussi à gagner la guerre et à imposer leur vision au monde entier. La vérité morale de cette condamnation ne dépend pas de l'opinion majoritaire, du consensus culturel ou des sentiments individuels.
Il est tout aussi crucial de clarifier ce que l'argument n'affirme pas, afin de prévenir les malentendus fréquents qui obscurcissent le débat.
- L'argument ne prétend pas que les athées ou les agnostiques ne peuvent pas être des personnes moralement bonnes ou mener une vie vertueuse. L'expérience quotidienne et l'histoire prouvent amplement le contraire.
- Il ne prétend pas non plus que l'on doit croire en Dieu pour reconnaître des vérités morales ou pour formuler un système éthique. De nombreux philosophes athées ont développé des systèmes éthiques complexes et admirables.
La question posée par l'argument n'est ni comportementale ni épistémologique (comment connaissons-nous la morale?), mais ontologique (quel est le fondement de l'être de la morale?). La question centrale est la suivante : « Si Dieu n'existe pas, est-ce qu'il peut y avoir réellement des valeurs morales objectives? ». Il s'agit de l'existence même d'un fondement pour la morale, et non de la capacité des individus à la percevoir ou à la pratiquer.
Prémisse 1 : Sans Dieu, pas de fondement pour une morale objective
La première prémisse est souvent la plus controversée, mais elle découle logiquement des implications d'une vision du monde athée et matérialiste. Si l'athéisme est vrai, alors l'univers n'est pas le produit d'une intelligence ou d'une intention. L'humanité est le résultat accidentel de processus physiques aveugles et non guidés, un simple « sous-produit » de la nature. Nous sommes, pour reprendre les mots du biologiste Richard Dawkins, des « machines à survie — des robots programmés à l'aveugle pour préserver les molécules égoïstes connues sous le nom de gènes ». Dans un tel univers, composé uniquement de matière et d'énergie régies par les lois de la physique, sur quelle base pourrait-on fonder une obligation morale transcendante, un « devoir-être » qui s'impose à nous?
Dans une perspective purement matérialiste, il n'y a, en dernière analyse, « ni dessein, ni but, ni mal, ni bien, rien qu'une indifférence aveugle et impitoyable ». Les actions humaines ne sont que des arrangements complexes d'atomes, et il n'y a aucune raison objective de préférer l'arrangement que nous appelons « compassion » à celui que nous nommons « cruauté ». Les devoirs moraux deviennent particulièrement inexplicables. Qui ou quoi nous impose ces obligations? Si l'univers est tout ce qui existe, il n'y a pas de législateur transcendant pour promulguer une loi morale. Par conséquent, le sentiment d'un devoir moral objectif doit être une illusion, une fiction utile développée au cours de notre évolution.
Sans Dieu, les tentatives de fonder la morale se réduisent inévitablement à deux options insatisfaisantes : la préférence personnelle ou la convention sociale.
- Si la morale est une préférence personnelle (subjectivisme), alors l'affirmation « Aider les pauvres est bien » n'est qu'une autre façon de dire « J'aime aider les pauvres ». Elle n'a pas plus de poids objectif que « J'aime la vanille ». Dans ce cadre, il devient impossible de condamner moralement des actions comme la torture ou le viol. On peut seulement dire qu'on ne les aime pas, mais l'auteur de ces actes peut légitimement répondre qu'il les aime, et il n'existe aucun arbitre objectif pour trancher le différend.
- Si la morale est une convention sociale (relativisme culturel), alors la moralité n'est rien de plus que l'ensemble des règles qu'une société particulière a adoptées pour sa propre cohésion. Dans ce cas, nous perdons toute base pour juger une culture comme étant moralement supérieure ou inférieure à une autre. Les lois de l'Allemagne nazie, l'apartheid en Afrique du Sud ou l'esclavage dans l'Amérique d'avant la guerre civile étaient simplement des conventions sociales différentes, ni plus ni moins « valides » que les nôtres. Nous ne pourrions plus parler de « progrès moral », mais seulement de « changement moral ».
Cette conclusion est si contre-intuitive que de nombreux penseurs athées, comme le philosophe J.L. Mackie, ont reconnu la difficulté. Mackie a admis que si des valeurs objectives existaient, elles seraient des entités si étranges et si différentes de tout le reste dans un univers naturaliste qu'elles rendraient l'existence de Dieu plus probable que son inexistence.
Au-delà de la simple existence de valeurs, la nature même de l'obligation morale pointe vers une source personnelle. L'expérience morale n'est pas seulement la reconnaissance que la compassion est une valeur ; c'est le sentiment d'un devoir, d'une obligation d'être compatissant. Ce « devoir-être » a le caractère d'un commandement, d'une loi qui s'adresse à notre volonté et la lie. D'où peut provenir une telle commande? Une force impersonnelle, comme la gravité, ou un principe abstrait, comme une vérité mathématique, ne peuvent pas émettre de commandements ni exiger une allégeance personnelle. On ne peut désobéir au théorème de Pythagore ou se sentir coupable envers lui. Les lois impliquent un législateur ; les commandements, un commandant. Comme l'a soutenu le philosophe Peter Kreeft, la seule source possible d'une autorité morale absolue et personnelle est une Volonté absolument parfaite et personnelle. Ainsi, la grammaire même de notre conscience morale — ce sentiment d'être redevable à une autorité qui nous commande de faire le bien — ne pointe pas simplement vers une norme abstraite, mais vers un Législateur personnel. L'argument moral ne conduit pas seulement à une « Cause Première » impersonnelle, mais à un Esprit et une Volonté qui sont la source du Bien et devant qui nos propres esprits et volontés sont responsables.
Prémisse 2 : L'existence indéniable des valeurs morales objectives
Si la première prémisse est une déduction philosophique sur les implications de l'athéisme, la seconde est une affirmation fondée sur l'expérience humaine la plus fondamentale. Nous vivons et agissons comme si les valeurs morales objectives étaient réelles. Notre indignation face à l'injustice, notre admiration pour le sacrifice, notre condamnation de la cruauté — tout cela témoigne de notre croyance innée en un ordre moral réel.
Malgré les variations culturelles en surface, un examen plus approfondi révèle un noyau de valeurs morales partagées par la quasi-totalité des civilisations à travers l'histoire. C.S. Lewis, dans son ouvrage L'abolition de l'homme, a documenté ce qu'il appelle le Tao, un ensemble de préceptes moraux fondamentaux (ne pas tuer d'innocents, prendre soin des siens, l'honnêteté, la justice) que l'on retrouve dans les enseignements des anciens Égyptiens, Babyloniens, Hindous, Chinois, Grecs et Romains. Il met au défi quiconque d'imaginer une culture où la lâcheté au combat serait admirée ou la trahison des bienfaiteurs serait une source de fierté. Une telle société serait aussi inconcevable qu'une société où 2+2=5.
Notre langage et nos interactions quotidiennes sont saturés d'appels à cette norme objective. Le simple fait de se quereller en est une preuve éclatante. Comme le note Lewis, lorsque deux personnes sont en désaccord, elles ne se contentent pas de s'affronter comme des animaux. Elles font appel à des règles qu'elles s'attendent à ce que l'autre reconnaisse : « Comment aimerais-tu qu'on te fasse la même chose? », « C'est ma place, j'étais là le premier », « Tu m'avais promis ». Ces phrases n'ont de sens que si l'on présuppose l'existence d'une loi ou d'une règle de fair-play commune. Même la personne qui prétend que toute morale est subjective se plaindra amèrement « Ce n'est pas juste! » si son portefeuille est volé, trahissant ainsi sa croyance instinctive en une norme objective.
De plus, certaines vérités morales sont si évidentes qu'elles s'imposent à nous avec la force d'une intuition irréfutable. Nous n'avons pas besoin d'un long raisonnement déductif pour savoir qu'infliger une souffrance atroce à un enfant pour son propre plaisir est un mal absolu. Le philosophe agnostique Michael Ruse l'a exprimé avec force : « L'homme qui dit qu'il est moralement acceptable de violer des petits enfants se trompe autant que l'homme qui dit : 2+2=5 ». La condamnation quasi universelle de pratiques comme le génocide, l'esclavage ou la discrimination raciale ne relève pas d'une mode culturelle, mais d'une reconnaissance progressive de vérités morales objectives qui étaient vraies même lorsque des cultures entières les niaient.
Enfin, l'existence des réformateurs moraux constitue un argument puissant contre l'idée que la morale est simplement ce qu'une culture approuve. Des figures comme Martin Luther King Jr., qui a lutté contre les lois ségrégationnistes de son époque, ou William Wilberforce, qui a combattu la traite des esclaves approuvée par l'Empire britannique, seraient, par définition, des figures immorales si la moralité n'était que la conformité aux normes sociales. Le fait que nous les considérions comme des héros moraux démontre que nous croyons en une loi de justice supérieure, un étalon de mesure par lequel les lois et les coutumes d'une société peuvent elles-mêmes être jugées et trouvées déficientes. Notre conscience reconnaît une autorité plus haute que celle de la société.
Les grandes voix de l'argument : C.S. Lewis et Emmanuel Kant
L'argument moral a été formulé de diverses manières à travers l'histoire de la pensée. Deux des formulations les plus influentes et les plus éclairantes proviennent de l'apologiste C.S. Lewis, qui part de l'expérience commune, et du philosophe Emmanuel Kant, qui part des exigences de la raison pure. Bien que leurs approches diffèrent, elles convergent vers une conclusion similaire.
La loi de la nature humaine selon Lewis
Dans les premiers chapitres de son œuvre magistrale, Les fondements du Christianisme (Mere Christianity), C.S. Lewis développe une version de l'argument moral d'une clarté et d'une puissance remarquables, accessible à tous. Son raisonnement repose sur deux observations fondamentales concernant la condition humaine.
Premier point : L'existence d'une loi partagée. Lewis observe que tous les êtres humains, à travers toutes les cultures et toutes les époques, ont cette « curieuse idée qu'ils devraient se comporter d'une certaine manière ». Il nomme cette idée la « Loi de la Nature Humaine » ou la Loi Morale. Il ne s'agit pas d'une loi physique comme la gravité, car, contrairement à une pierre qui tombe, nous sommes libres de lui désobéir. C'est la seule loi que l'homme est libre d'enfreindre. Néanmoins, elle se présente à notre conscience comme une réalité objective, une norme de comportement décent que nous connaissons tous intuitivement.
Deuxième point : La transgression universelle de cette loi. La seconde observation de Lewis est tout aussi cruciale : personne ne respecte parfaitement cette loi. Nous connaissons tous la norme, et nous la violons tous constamment. Lorsque nous échouons, notre première réaction n'est pas d'admettre notre faute, mais de chercher des excuses, de plaider des circonstances atténuantes, de prétendre que notre cas est une exception spéciale. Ce besoin de se justifier ne fait que confirmer à quel point nous croyons en la réalité de la loi que nous venons de transgresser.
L'inférence à un Législateur. Pour Lewis, ces deux faits — le fait que nous connaissons une loi morale et le fait que nous la transgressons — sont des indices fondamentaux sur la nature de la réalité. L'existence de la loi suggère qu'il y a une intelligence, un Législateur derrière l'univers, car une loi morale implique un esprit qui la conçoit. Un univers purement matériel ne produit pas de « devoirs ». Notre incapacité à respecter cette loi révèle notre situation précaire face à ce Législateur. Nous sommes en porte-à-faux avec la réalité morale fondamentale de l'univers, ce qui crée un problème que nous ne pouvons résoudre par nous-mêmes.
Le postulat de la raison pratique chez Kant
L'approche d'Emmanuel Kant est plus abstraite et philosophique, mais elle aboutit à une conclusion structurellement similaire. Dans sa Critique de la raison pure, Kant avait soutenu que l'existence de Dieu ne pouvait être prouvée par la raison théorique (scientifique ou métaphysique). Cependant, dans sa Critique de la raison pratique, il affirme que l'existence de Dieu est un postulat nécessaire pour que la vie morale ait un sens ultime.
Le point de départ de Kant est l'« impératif catégorique », le commandement inconditionnel de la raison qui nous enjoint d'agir moralement, de faire notre devoir pour le devoir lui-même. Cependant, Kant observe que l'être humain n'est pas seulement un être rationnel, mais aussi un être sensible qui aspire naturellement au bonheur. Le but ultime de l'existence humaine, qu'il nomme le « Souverain Bien », serait l'union parfaite de la vertu et du bonheur.
Le problème est que, dans ce monde, il n'y a aucune garantie que la vertu mène au bonheur. Au contraire, nous voyons souvent les justes souffrir et les méchants prospérer. Si l'univers était ultimement indifférent à la moralité, alors l'effort moral serait, en fin de compte, irrationnel et absurde. Pour que la quête de la vertu ne soit pas vaine, la raison pratique doit postuler (c'est-à-dire supposer comme une condition nécessaire) deux choses :
- L'immortalité de l'âme : car la perfection morale ne peut être atteinte dans cette vie limitée.
- L'existence de Dieu : comme une puissance juste et omnipotente capable de garantir qu'à la fin, la vertu sera récompensée par le bonheur qu'elle mérite.
Pour Kant, Dieu n'est donc pas le fondement de la loi morale elle-même (qui vient de la raison autonome), mais il est la condition nécessaire à sa cohérence ultime. Sans Dieu, l'univers moral serait un chaos injuste, et l'impératif de la conscience, une exigence absurde.
Tableau 1 : Comparaison des approches de l'argument moral
Le tableau suivant synthétise ces différentes formulations pour en souligner les nuances et les complémentarités.
| Caractéristique | Approche de C.S. Lewis | Approche de Kant | Approche classique |
| Point de départ | L'expérience universelle du conflit moral et du sentiment de "juste/injuste". | L'exigence de la raison pratique pour que la morale soit ultimement cohérente. | L'existence de faits moraux objectifs et de devoirs contraignants. |
| Concept clé | La "Loi de la Nature Humaine". | Le "Souverain Bien" (l'union de la vertu et du bonheur). | Le fondement ontologique des valeurs morales objectives. |
| Conclusion sur Dieu | Un Législateur moral derrière l'univers. | Un Postulat nécessaire de la raison pratique qui garantit la justice cosmique. | Le fondement métaphysique du Bien, dont la nature est la norme morale. |
Répondre aux objections courantes
Comme tout argument philosophique, l'argument moral fait face à des critiques sérieuses qui méritent une réponse attentive. Examiner ces objections permet non seulement de renforcer la validité de l'argument, mais aussi d'en approfondir la compréhension.
Le relativisme moral : une illusion intenable?
L'objection la plus répandue aujourd'hui est celle du relativisme moral, l'idée que la morale est entièrement une construction culturelle et qu'il n'existe aucune norme universelle.
Toutefois, cette position, bien que populaire, s'avère philosophiquement fragile.
- Elle est souvent auto-contradictoire. Le relativiste affirme fréquemment que « nous ne devrions pas imposer notre morale aux autres cultures ». Or, cette affirmation est elle-même un jugement moral présenté comme universellement vrai. Le relativiste pose au moins une valeur absolue : la tolérance. Il se réfute donc lui-même.
- Elle rend le progrès moral impossible. Si le relativisme est vrai, alors le passage d'une société esclavagiste à une société abolitionniste n'est pas un progrès, mais un simple changement de coutumes, sans valeur intrinsèque. L'œuvre de réformateurs comme Martin Luther King Jr., qui a défié les lois de sa propre société au nom d'une justice supérieure, devient incohérente. Notre admiration pour de telles figures montre que nous ne sommes pas de vrais relativistes.
- Elle est contredite par l'expérience de la justice internationale. Le procès de Nuremberg, qui a jugé les dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale, a été fondé sur le principe qu'il existe des « crimes contre l'humanité ». Cette notion présuppose une loi morale supérieure aux lois de n'importe quel État. En condamnant ces hommes, les Alliés n'ont pas dit « Votre morale était différente de la nôtre », mais « Ce que vous avez fait était objectivement et absolument mal », quel que soit le système juridique allemand de l'époque.
L'évolution peut-elle expliquer le devoir moral?
Une autre objection majeure, issue d'une vision naturaliste du monde, soutient que notre sens moral n'est qu'un produit de l'évolution, un instinct de troupeau qui a favorisé la survie de l'espèce humaine.
Cette explication, bien que séduisante, confond plusieurs niveaux de réalité.
- Elle commet l'erreur du « est » au « doit être » (le problème de Hume). La biologie évolutive peut, au mieux, décrire comment certains comportements altruistes ont pu émerger (un fait, un « est »). Elle ne peut en aucun cas nous dire pourquoi nous devrions obéir à ces impulsions (une prescription, un « doit être »). La science décrit ce qui se passe ; elle ne peut pas fonder ce qui doit se passer. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour le bien du pool génétique de l'espèce? La biologie n'offre aucune raison contraignante.
- Elle n'explique pas le jugement entre les instincts. Comme le souligne C.S. Lewis, nous sommes souvent tiraillés entre des instincts contradictoires : l'instinct de conservation nous dit de fuir le danger, tandis que l'instinct grégaire nous pousse à aider une personne en détresse. La loi morale n'est pas l'un de ces instincts ; elle est ce qui nous dit lequel suivre. Elle est comme la partition qui indique au pianiste quelle touche jouer. Elle se situe au-dessus des instincts et les juge, elle ne peut donc pas être l'un d'entre eux.
- Elle confond l'altruisme biologique et le devoir moral. L'altruisme biologique est un comportement qui profite à un autre au détriment de soi, souvent expliqué par des mécanismes comme la sélection de parentèle (aider ses proches pour préserver ses gènes) ou l'altruisme réciproque (aider en espérant être aidé en retour). Le devoir moral objectif, cependant, est une obligation qui s'étend aux étrangers, aux ennemis, et même aux générations futures, sans aucune attente de bénéfice génétique ou de réciprocité. Le premier est une stratégie de survie ; le second est un commandement désintéressé.
Le dilemme d'Euthyphron : une fausse alternative
Cette objection, formulée par Platon il y a plus de deux millénaires, reste un défi classique à la morale théiste. Elle se présente sous la forme d'une question : « Ce qui est pieux (ou bon) est-il aimé des dieux parce qu'il est pieux, ou est-il pieux parce qu'il est aimé des dieux? ». Appliquée au monothéisme, la question devient : « Dieu commande-t-il le bien parce qu'il est bien, ou le bien est-il bien parce que Dieu le commande? ».
- Si l'on choisit la première option, il semble que le bien soit une norme indépendante et supérieure à Dieu, à laquelle Dieu lui-même doit se conformer. Dieu ne serait plus le fondement ultime de la morale.
- Si l'on choisit la seconde option, la morale devient arbitraire. Dieu aurait pu commander la haine, la cruauté et le mensonge, et ces choses seraient devenues bonnes par simple décret de sa volonté.
La tradition théologique chrétienne, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, a toujours répondu qu'il s'agit là d'une fausse dichotomie. Il existe une troisième voie qui résout le dilemme : Dieu commande ce qui est bien parce qu'Il est le Bien. L'étalon du bien n'est ni une loi abstraite au-dessus de Dieu, ni un caprice arbitraire de sa volonté. L'étalon du bien est la nature même de Dieu : son caractère immuable, parfait, juste et aimant. Comme le dit saint Thomas, « la justice est un attribut essentiel de la nature divine ». Par conséquent, les commandements de Dieu ne sont pas arbitraires ; ils découlent nécessairement de son être même. Dieu ne pourrait pas commander la cruauté pour la même raison qu'il ne pourrait pas créer un cercle carré : cela contredirait sa propre nature. La morale n'est donc ni indépendante de Dieu, ni arbitraire ; elle est fondée sur son caractère éternel.
Tableau 2 : Synthèse des objections et des réponses apologétiques
Ce tableau offre un résumé concis des principaux défis à l'argument moral et des réponses classiques, servant de guide pratique pour la discussion.
| Objection | Résumé de l'objection | Réponse |
| Relativisme Moral | La morale est une construction culturelle ; il n'y a pas de vérité morale universelle. | S'auto-réfute (la tolérance est posée comme valeur universelle), rend le progrès moral impossible, et ne peut rendre compte de la justice supranationale (ex: Nuremberg). |
| Éthique Évolutionniste | Le sens moral est un instinct biologique qui a évolué pour la survie de l'espèce. | Confond la description (« est ») avec la prescription (« doit être »). N'explique pas pourquoi nous devrions obéir à un instinct plutôt qu'à un autre, ni le devoir envers ceux qui ne nous apportent aucun avantage de survie. |
| Dilemme d'Euthyphron | La morale est soit indépendante de Dieu (Il la commande parce qu'elle est bonne), soit arbitraire (elle est bonne parce qu'Il la commande). | Fausse dichotomie. Le bien est fondé dans la nature même de Dieu. Dieu commande le bien parce qu'Il est le Bien. La morale n'est ni extérieure à Lui ni arbitraire. |
L'éclairage de la tradition catholique : la loi naturelle
L'argument moral, bien que formulable en termes purement philosophiques, trouve son ancrage le plus profond et son expression la plus riche dans la doctrine catholique de la loi naturelle. Ce que la raison identifie comme une « loi morale » universelle, la foi le reconnaît comme la lumière de l'intelligence divine brillant en nous.
Participer à la Sagesse éternelle de Dieu
Pour saint Thomas d'Aquin, le plus grand docteur de l'Église, la loi naturelle n'est rien d'autre que « la participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable » (participatio legis aeternae in rationali creatura). La loi éternelle est la sagesse divine elle-même, le plan providentiel par lequel Dieu gouverne toute la création vers sa fin. Tandis que les créatures irrationnelles (animaux, plantes, minéraux) participent à cette loi de manière passive, en suivant les instincts et les lois physiques inscrits dans leur être, l'être humain, créé à l'image de Dieu, y participe de manière active et intelligente. Par notre raison, nous sommes capables de discerner les fins fondamentales de notre nature et de nous y ordonner librement. Notre raison morale n'invente donc pas des valeurs à partir de rien ; elle découvre un ordre moral objectif, une grammaire de l'être inscrite dans la réalité par le Créateur.
Les préceptes inscrits dans notre nature
Le contenu de cette loi naturelle n'est pas un code secret, mais il est accessible à toute personne qui réfléchit sur les inclinations fondamentales de la nature humaine. Dans la Somme Théologique (I-II, q. 94, a. 2), saint Thomas d'Aquin expose la structure de ces préceptes.
Le tout premier principe de la raison pratique, l'axiome fondamental de toute action, est : « Le bien est ce que tous les êtres désirent ». De là découle le premier précepte de la loi naturelle : « Il faut faire et rechercher le bien, et éviter le mal ». Tous les autres préceptes ne sont que des spécifications de celui-ci, basées sur l'ordre de nos inclinations naturelles :
- L'inclination à la conservation de son être : C'est une inclination que l'homme partage avec toutes les substances. De là découlent les préceptes concernant la protection de la vie, la santé, et le droit à la légitime défense.
- L'inclination à des biens plus spécifiques partagés avec les animaux : Cela inclut l'union du mâle et de la femelle et l'éducation des enfants. De là découlent les préceptes concernant le mariage, la famille et la responsabilité parentale.
- L'inclination au bien conforme à la nature de la raison : C'est ce qui est propre à l'homme. Cela inclut l'inclination naturelle à connaître la vérité (en particulier sur Dieu) et à vivre en société. De là découlent les préceptes qui nous commandent de fuir l'ignorance, de ne pas nuire à ceux avec qui nous devons vivre, de rendre à chacun son dû, et de chercher Dieu.
Enseignement du Magistère
Le Catéchisme de l'Église Catholique réaffirme avec force cet enseignement constant. Il déclare que la loi naturelle, « présente dans le cœur de chaque homme, et établie par la raison, [est] universelle en ses préceptes et son autorité s'étend à tous les hommes. Elle exprime la dignité de la personne et détermine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux » (§ 1956). Même si son application peut varier selon les cultures et les circonstances, elle « demeure comme une règle reliant entre eux les hommes et leur imposant, au-delà des différences inévitables, des principes communs » (§ 1957). Elle constitue ainsi le fondement indispensable de toute loi civile juste et de la reconnaissance des droits humains universels.
Conclusion : De la loi morale au Dieu personnel et au besoin d'un Sauveur
Au terme de ce parcours rationnel, le portrait du fondement de la morale se dessine avec une clarté grandissante. L'argument moral ne nous laisse pas avec une force impersonnelle ou un principe abstrait. La source d'une loi morale doit être un Législateur. La source de valeurs objectives doit être le Bien absolu lui-même. La source d'un devoir contraignant qui s'adresse à des personnes doit être une Autorité personnelle. L'argument moral, dans sa plénitude, pointe vers une réalité qui est à la fois intelligente, souverainement bonne et personnelle — les attributs mêmes du Dieu du théisme classique.
Cependant, c'est ici que l'apologétique de C.S. Lewis révèle toute sa profondeur pastorale. La loi morale, une fois reconnue, a un double effet sur la conscience humaine. D'une part, elle est un témoin de l'existence de Dieu. D'autre part, elle est un témoin de notre propre faillite. Nous connaissons la loi, mais nous sommes incapables de l'accomplir parfaitement. La même loi qui nous montre le chemin vers Dieu nous sert aussi de miroir, révélant notre péché et notre aliénation de cette norme parfaite. La loi qui nous attire vers le Bien nous condamne aussi en tant que transgresseurs de ce Bien.
Cette prise de conscience de ce que le théologien John Hare appelle le « fossé moral » (moral gap) est le préambule essentiel à l'Évangile. Comme le dit Lewis, le christianisme « n'a tout simplement pas de sens tant que vous n'avez pas fait face à ce genre de faits ». L'Évangile annonce le repentir et promet le pardon, mais ces concepts restent vides de sens pour celui qui ne se sent pas coupable d'avoir enfreint une loi réelle. La loi morale nous montre notre maladie et nous fait ainsi comprendre notre besoin d'un médecin. Elle nous révèle notre situation de débiteurs insolvables et nous prépare à accueillir la nouvelle d'une grâce qui annule la dette.
L'argument moral n'est donc pas une fin en soi. C'est un praeparatio evangelica, une préparation à l'Évangile. Il conduit l'esprit honnête jusqu'au seuil de la foi, en déblayant les obstacles intellectuels du relativisme et du matérialisme. Il démontre la rationalité d'un univers moralement ordonné et, ce faisant, expose la blessure au cœur de l'homme, une blessure que seule la grâce de Jésus-Christ peut guérir. La loi inscrite dans nos cœurs, dont parle saint Paul dans son Épître aux Romains (2:14-15), trouve son auteur, son sens plénier et son accomplissement ultime en Celui qui n'est pas seulement le Législateur, mais le Verbe fait chair, l'incarnation personnelle du Bien, de la Vérité et de la Beauté.
Articles similaires

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu: 1er janvier

Mais Dieu seul peut pardonner les péchés!

Pourquoi les images bibliques nous semblent parfois si étranges?

Existence de Dieu : Les erreurs des philosophes modernes (6/7)

Saint Barthélémy: 24 aout

12 juillet 2015 : 15e dimanche du Temps Ordinaire

Qu’est-ce qu’un raisonnement circulaire?

« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie
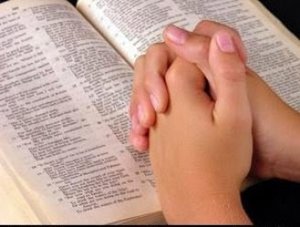
Prière, science et existence de Dieu
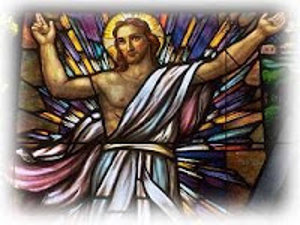
Jésus est-il Dieu : Jésus a-t-il affirmé être Dieu ?

Les 8 attributs de Dieu

Dieu est-il une idée stupide? (dialogue socratique)
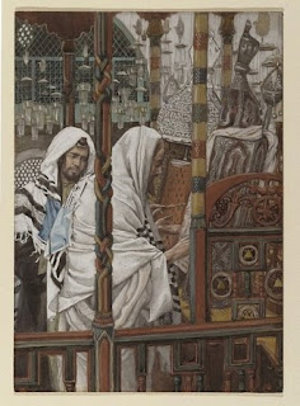
La puissance de la « lectio divina »
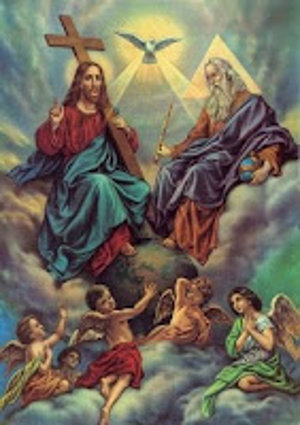
Jésus et les attributs de Dieu

Le Concile de Trente (1545-1563) : La réponse catholique à la Réforme protestante

Fête de Sainte Scholastique: 10 février
Ces articles douteux : Marie, une idole est née
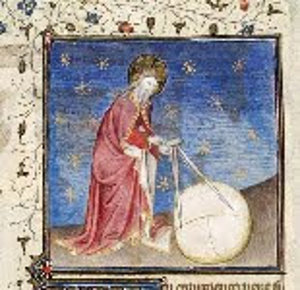
Dieu est une personne

Les paroles de Jésus au bon larron réfutent-elles la nécessité du baptême