
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence (1431-1449) : Tentative de réunification avec l'Église orthodoxe et affirmation de l'autorité papale
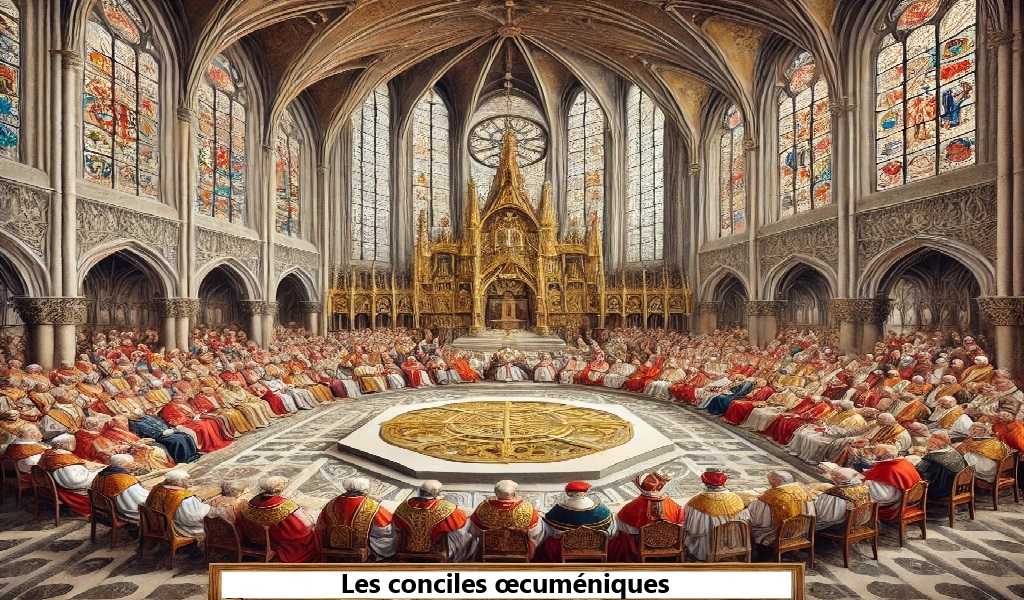
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence, tenu de 1431 à 1449, est le dix-septième concile œcuménique de l'Église catholique. Ce concile fut initialement convoqué pour poursuivre la réforme de l'Église et tenter de rétablir l'unité avec l'Église orthodoxe. Cependant, il fut marqué par des tensions entre les conciliaristes, qui soutenaient la suprématie du concile général sur le pape, et la papauté elle-même. Ces tensions conduisirent à un déplacement du concile de Bâle à Ferrare, puis à Florence, où il se concentra principalement sur le dialogue avec les Églises orientales.
Contexte historique et théologique
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence se déroula dans une période de crises multiples pour l'Église. À la suite du Concile de Constance (1414-1418), qui avait mis fin au Grand Schisme d'Occident, l'Église catholique faisait face à de nouvelles pressions pour réformer sa gouvernance et répondre aux critiques internes. Le mouvement conciliariste, qui soutenait que le concile général avait autorité sur le pape, avait gagné en influence, notamment par le décret Haec Sancta de Constance.
Le pape Martin V, qui avait été élu à Constance, et son successeur Eugène IV, se méfiaient du conciliarisme mais ne pouvaient pas l'ignorer en raison de son large soutien. En 1431, le pape Eugène IV convoqua le concile à Bâle pour répondre aux demandes de réforme, réformer la discipline ecclésiastique, et traiter la question des hérésies, notamment les hussites en Bohême. Cependant, le concile se heurta rapidement à la papauté sur la question de l'autorité.
En parallèle, l'empereur byzantin Jean VIII Paléologue, face à la menace croissante des Ottomans, chercha l'aide de l'Occident et proposa un dialogue pour rétablir l'unité entre les Églises d'Orient et d'Occident, séparées depuis le schisme de 1054. Cela conduisit à un déplacement du concile de Bâle à Ferrare en 1438, puis à Florence en 1439.
Les décisions et événements majeurs du Concile
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence se déroula en deux phases principales, avec des décisions et des événements significatifs dans chaque phase :
Phase de Bâle (1431-1437) : Le concile, réuni à Bâle, tenta de réformer l'Église, de traiter les questions disciplinaires, et de réaffirmer la supériorité du concile sur le pape. Les conciliaristes proclamèrent la primauté de l'autorité conciliaire sur l'autorité papale et promulguèrent des décrets réformateurs, notamment concernant les abus financiers et la simonie. Eugène IV, inquiet de l'excès de pouvoir conciliaire, ordonna la dissolution du concile en 1433, mais les pères du concile refusèrent et continuèrent à siéger. En 1437, Eugène IV décida de déplacer le concile à Ferrare pour y convoquer les représentants de l'Église orthodoxe afin de discuter de l'union des Églises.
Phase de Ferrare (1438) et de Florence (1439-1445) : Le concile se déplaça à Ferrare en 1438, puis à Florence en 1439, à cause d'une épidémie de peste à Ferrare. Le principal objectif devint alors la réunification avec l'Église orthodoxe grecque. À Florence, les discussions entre les représentants de l'Église catholique et les délégués de l'Église orthodoxe aboutirent à la proclamation d'une union formelle entre les deux Églises en 1439, avec la signature du décret Laetentur Caeli. Ce décret reconnut la primauté papale, l'ajout du Filioque au Credo, et l'acceptation des autres doctrines latines controversées, telles que le purgatoire et l'utilisation du pain azyme dans l'Eucharistie.
Lutte contre les hussites et autres hérétiques : Le concile à Bâle tenta de résoudre le conflit avec les hussites, un mouvement réformateur en Bohême inspiré par Jan Hus, en proposant des discussions et des compromis. En 1433, une partie des hussites, les utraquistes, accepta un accord appelé les Compactata de Prague, qui autorisait la communion sous les deux espèces (pain et vin) pour les laïcs, ce qui était une victoire partielle du concile.
Réforme de l'Église : Le concile promulgua des réformes contre la simonie, le népotisme, et les abus ecclésiastiques. Cependant, ces réformes eurent peu d'impact durable, car le concile fut interrompu et les réformes ne furent pas largement mises en œuvre après la fin du concile.
Déplacement du concile à Rome (1445-1449) : Après la proclamation de l'union avec l'Église orthodoxe à Florence, le concile se déplaça finalement à Rome en 1445 pour conclure ses travaux. Toutefois, en 1449, le pape Nicolas V déclara que le concile était officiellement clos, mettant fin à cette longue période de discussions.
Importance et impact du Concile de Bâle-Ferrare-Florence
Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence est significatif pour plusieurs raisons. D'abord, il marqua une confrontation majeure entre le conciliarisme et la papauté. La tentative du concile de réaffirmer sa supériorité sur le pape et la résistance de la papauté conduisirent à une clarification de l'autorité papale. Bien que le conciliarisme ait perdu son influence après ce concile, l'idée que l'Église pouvait être réformée collectivement par un concile général eut un impact durable.
Le concile est également connu pour sa tentative de réunification avec l'Église orthodoxe, qui aboutit à la proclamation de l'union de Florence. Cette union, bien que signée par les représentants byzantins, ne fut jamais acceptée par la majorité du clergé et des fidèles orthodoxes, et elle fut rapidement annulée après la chute de Constantinople en 1453. Néanmoins, ce fut l'une des tentatives les plus sérieuses pour rétablir l'unité chrétienne depuis le schisme de 1054, et elle témoigne du désir persistant de réconciliation entre les Églises.
Le concile contribua également à la réforme de l'Église en promulguant des décrets contre les abus ecclésiastiques et en tentant de résoudre les conflits internes. Bien que les réformes concrètes soient restées limitées, le concile de Bâle-Ferrare-Florence reflète un engagement renouvelé pour réformer l'Église face aux critiques croissantes qui mèneraient plus tard à la Réforme protestante.
Représentation et actualité du Concile de Bâle-Ferrare-Florence aujourd'hui
Aujourd'hui, le Concile de Bâle-Ferrare-Florence est un exemple important des efforts de l'Église catholique pour répondre aux défis internes et externes au cours de l'époque médiévale tardive. Il montre comment l'Église a cherché à naviguer entre la réforme nécessaire, les tensions politiques et les efforts œcuméniques pour restaurer l'unité chrétienne.
Le concile rappelle également l'importance de la clarté sur la gouvernance ecclésiale, en particulier en ce qui concerne l'autorité du pape par rapport au concile général. Cette question reste pertinente dans les discussions théologiques et ecclésiologiques contemporaines sur la nature de l'autorité dans l'Église.
Enfin, le Concile de Bâle-Ferrare-Florence met en lumière le désir constant d'unité chrétienne. Les efforts pour rétablir l'unité avec l'Église orthodoxe témoignent de l'importance de l'œcuménisme, un thème qui continue de résonner fortement dans le dialogue entre les Églises aujourd'hui. Le concile nous rappelle que, malgré les divisions, il existe toujours un désir de réconciliation et de compréhension mutuelle au sein de la chrétienté.
Articles similaires

Le Sédévacantisme

Le Concile de Latran III (1179) : Réforme de l'élection papale et lutte contre les hérésies

Le Concile de Lyon II (1274) : Tentative de réunification avec les Églises orientales et réforme ecclésiastique

Le Concile Vatican I (1869-1870) : Définition de l'infaillibilité pontificale et réponse au monde moderne

Le Concile de Constantinople IV (869-870) : La condamnation du schisme de Photius et la primauté du pape

Le Concile de Constantinople I (381) : La confirmation de la doctrine de la Trinité

Introduction aux grands conciles de l'Église : pourquoi sont-ils essentiels pour comprendre la foi catholique aujourd'hui ?
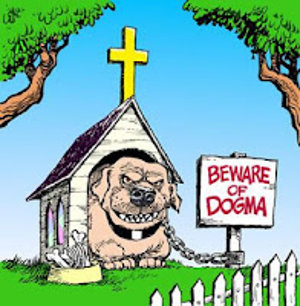
« Ne soyez pas si dogmatique! »

Le Concile Vatican II (1962-1965) : Renouveau et ouverture de l'Église au monde moderne

À la découverte de Jésus et de la Bible
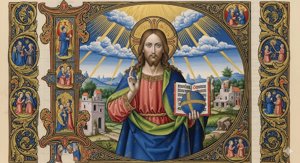
Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ

Existence de Dieu : Par le raisonnement (1/7)

Le Concile de Constantinople II (553) : La confirmation des décisions précédentes et la condamnation des « Trois Chapitres »

Le Concile de Nicée I (325) : L'affirmation de la divinité du Christ

Le Concile de Constance (1414-1418) : Fin du Grand Schisme d'Occident et réformes ecclésiastiques

Un voyage au cœur de la foi catholique

Le Concile de Nicée II (787) : La défense des saintes images et la fin de l'iconoclasme

Le Concile de Trente (1545-1563) : La réponse catholique à la Réforme protestante

L’Inspiration des Écritures
